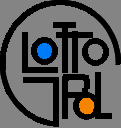
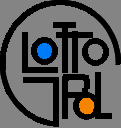
| Robillard D. de, 2008 (sous presse), Perspectives alterlinguistiques, vol. 1 : Démons, vol. 2 : Ornithorynques, Paris, L'Harmattan, 302 p., 202 p. par Claude Caitucoli (E.A. LIDIFra - Université de Rouen) |
L’exercice auquel je me livre ici n’est pas à strictement parler celui, bien balisé, du compte rendu scientifique, de la recension. En effet, au moment où j’écris ces lignes (avril 2008), les deux tomes de Perspectives alterlinguistiques sont encore en préparation(1). Je me livre donc à un exercice plus souvent pratiqué par les journalistes que par les universitaires, qui consiste à annoncer un ouvrage à paraître. Les produits qui bénéficient de ce type de lancement dans la presse sont généralement des livres « attendus », dont on sait qu’ils susciteront des polémiques. Le lancement journalistique est souvent accompagné de quelques extraits croustillants. Vous ne trouverez pas dans ce numéro de Glottopol les « bonnes pages » de Perspectives alterlinguistiques. Pour le reste, notre revue fait bien un scoop en présentant ce texte, particulièrement ambitieux, où Didier de Robillard réfléchit, un siècle après le Cours de Saussure(2), quarante-cinq ans après les premiers travaux de William Labov, à ce que pourrait être une linguistique vraiment « remise sur ses pieds ».
Les deux tomes de Perspectives alterlinguistiques appartiennent à un genre qu’on peut appeler « discours de refondation scientifique » : examen critique d’une discipline classique et reconnue, ici « la technolinguistique », propositions pour une nouvelle discipline, ici « l’ontolinguistique ».
Ce que l’auteur nomme « la technolinguistique », ou par la suite « la LaLinguistique », est ce que d’autres auteurs ont pu qualifier, de façon polémique, de « zérolinguistique » ou de « linguistique consonne-voyelle ». Ses principes sont calqués sur ceux des sciences dures : démarche hypothético-déductive, analyse de données présentées comme objectives et permettant de vérifier des lois générales, modélisation. La technolinguistique construit des « LSDH », c’est-à-dire des « Langues Stabilisées-Décontextualisées-Déshistoricisées-Homogénéisées » (I-133 et passim).
Face à cette discipline hégémonique qui se présente comme le noyau dur des sciences du langage et tend à marginaliser, quand ce n’est pas à discréditer, toute autre approche, l’auteur argumente en faveur d’une démarche ontolinguistique, dont la devise pourrait être : « je cherche des hommes, pas des systèmes » (I-126). L’ontolinguistique construit des « LICH », c’est-à-dire des « Langues Instables-Contextualisées-Historicisées-Hétérogènes » (I-138 et passim).
Pour autant, Perspectives alterlinguistiques ne cherche pas à renvoyer dans les ténèbres préscientifiques les approches contre lesquelles l’ouvrage est bâti. En cela il constitue un discours de refondation atypique : il a peu de points communs, sur le plan formel, avec, par exemple, Syntactic Structures (Chomsky, 1957). Face à la linguistique dominante, positiviste, pratiquant une épistémologie de la réfutation fondée sur l’expérimentation et tenant donc, inévitablement, un discours d’exclusion, Didier de Robillard montre que d’autres linguistiques sont envisageables. Ces linguistiques ne seraient plus positivistes mais constructivistes. Elles pratiqueraient une herméneutique du dévoilement fondée sur l’expérienciation. L’alterlinguistique, telle que Didier de Robillard la conçoit, n’est pas une « autre linguistique » (I-108) qui aurait pour objectif d’invalider les approches concurrentes mais une « linguistique de l’autre » (ibid.). Elle admet donc, par principe, la multiplicité des points de vue.
C’est pourquoi on ne trouvera pas, dans mon compte rendu, un résumé de l’ouvrage mettant en évidence la parfaite ordonnance de sa structure. Une telle démarche, outre qu’elle serait vouée à l’échec, serait contraire à l’esprit-même du texte, fait de « tâtonnements revendiqués, de trajectoires, peut-être équivalentes, interchangeables selon les contextes » (I-6). Au demeurant, le lecteur pourra se reporter ci-dessus (pp. 255-256) à l’annexe du compte rendu que Didier de Robillard a rédigé pour ce numéro. Les thèses qu’il défend y sont présentées de façon claire et synthétique. Je reprendrai simplement certaines de ses propositions en montrant en quoi elles éclairent ma propre expérience d’enseignant-chercheur dirigeant une revue de sociolinguistique, travaillant dans un département et un laboratoire dont l’ancrage sociolinguistique est une donnée historique.
Dès le début, le lecteur est averti : « l’objectif de ce livre n’est pas de projeter l’image de “domination” et de “maîtrise” d’un objet achevé “parfait ” » (I-6) mais de faire en sorte « que chacun puisse constater comment <le chercheur> opère, et puisse donc juger de la qualité de sa production à la façon dont elle se fabrique » (I-55). En cela, l’auteur ne fait qu’appliquer à son propre texte des principes qu’il considère comme indissociables de l’approche ontologique et qui, pour la plupart, vont à rebours des tendances dominantes.
Si la recherche est conçue comme la rencontre singulière entre un sujet et un terrain, une « expérienciation », il s’ensuit que le chercheur doit faire en sorte que – pour reprendre une expression convenue dont on ne mesure pas toujours la portée – tout le monde comprenne « d’où cela parle ». Sur ce plan, le lecteur de Perspectives alterlinguistiques ne sera pas déçu. Très classiquement, il trouvera un examen critique des théories dominantes (pour la linguistique, Saussure, Martinet, Chomsky, Labov ; pour l’épistémologie générale, Popper, Kuhn etc.) ainsi qu’une présentation détaillée des apports théoriques essentiels sur lesquels Didier de Robillard s’appuie (pour la linguistique, Frei, Manessy, Marcellesi, Chaudenson, Prudent, Auroux, Baggioni, Heller, Lodge, Calvet ; pour l’épistémologie générale, Morin, Ricoeur, Veyne, Latour). De façon moins classique, le lecteur trouvera aussi des éléments pour un récit de vie de l’auteur, de Maurice à Tours en passant par Aix-Marseill e et la Réunion. Didier de Robillard, s’il tient à éviter « toute complaisance ou exhibition gratuite ou égotiste » (I-81) prend tout de même le temps – plusieurs dizaines de pages – de multiplier les détails et les anecdotes qui éclairent sa trajectoire de chercheur, des plus conventionnelles (les origines mauriciennes, le trilinguisme, les créoles, les rencontres intellectuelles) aux plus improbables, telles le désordre du bureau d’un professeur ou la pratique du kayak en eau vive, qui nourrit métaphoriquement le troisième chapitre de l’ouvrage : « Les paradoxes de l’eau dure, se produire, s’assumer, se revendiquer linguiste (de l’)hétérogène ».
Quant au deuxième chapitre, intitulé « (Dés)Ecrire la recherche », il pourrait constituer la base d’un anti-manuel d’écriture scientifique. Contre le principe d’effacement du sujet, l’auteur argumente en faveur d’un récit de recherche écrit à la première personne du singulier. Contre les recommandations de ceux qui réduisent la mise en mots « à un simple emballage, à une opération cosmétique, par rapport à une réalité de la science, plus profonde », Didier de Robillard considère que « l’écriture est un moyen de la recherche tout court, et de communication de la recherche de surcroît (ce qui en fait partie) » et qu’elle const itue, en dernière analyse, « une variable de l’éthique du chercheur » (I-63). Contre la tyrannie du modèle, par nature réductionniste, dont la fonction est de brider l’imagination du chercheur en traçant les limites du possible dans une logique « SDH »(3), l’auteur défend la métaphore, qui met en correspondance des univers différents et qui est « productrice de sens entre altérités » (I-66). De façon plus générale, à la métalangue, caractéristique de la logique « SDH », il propose de substituer « l’isolangue », « traduction (…) par un individu ou groupe historicisé, pour quelqu’un d’autre d’aussi historicisé » (I-65).
Dans cette opposition entre technolinguistique et ontolinguistique, quel statut doit-on accorder à la sociolinguistique ? Je peux formuler cette question de façon plus contextualisée : Glottopol, qui s’autodésigne comme une « revue de sociolinguistique en ligne », pourrait-elle être considérée comme une revue d’ontolinguistique ?
Il est clair que pour Didier de Robillard, l’ontolinguistique est une sociolinguistique. Il précise d’ailleurs qu’on peut « conserver “sociolinguistique” lorsqu’il n’est pas important de préciser que l’on se place dans le cadre de réflexion esquissé ici » (I-126). En réalité, s’il propose de substituer onto à socio, c’est pour se démarquer de la sociolinguistique « classique », d’inspiration labovienne notamment.
Il reproche à cette sociolinguistique d’accepter – sinon dans les professions de foi, du moins dans les faits – un statut de discipline seconde en entérinant la hiérarchie science fondamentale / science appliquée que lui impose la technolinguistique, autoproclamée fondamentale. Il lui reproche aussi de se couler dans le moule de la technolinguistique sans remettre en cause ses concepts essentiels, ses approches théoriques et méthodologiques, ses modes d’évaluation des résultats, ce qui la condamne à demeurer l’excroissance la plus molle d’une science humaine qui se donne comme modèle les sciences dures.
Mais, pour Didier de Robillard, le phénomène le plus grave est de nature éthique-politique :
« En acceptant les présupposés de l’épistémologie technolinguistique, certains sociolinguistes souscrivent également aux implicites sous-jacents, éthiquement, politiquement très inquiétants, à savoir que l’identité serait fixe, codée, stable, et manifestée par des marques linguistiques ayant les mêmes caractéristiques.(…) L’histoire nous a appris ce que risquent de produire des identités fixes, que l’on dit arrimées à des indices matériels jugés ou rendus univoques tels la couleur de la peau, la langue, le territoire. » (I-158-159).
Cette prise en compte de la dimension éthique-politique est sans doute ce qui permet de caractériser la démarche ontolinguistique :
« L’interprétation du monde se fait en fonction de ce que l’on en perçoit, des représentations que l’on en a, mais aussi également en fonction de ce que l’on veut en faire. » (I-106).
Dès lors, et à plus forte raison lorsqu’on s’affranchit des logiques unimodales, le seul critère qui permet de choisir entre deux constructions, deux représentations du monde, que ces représentations soient les représentations ordinaires des témoins ou les représentations savantes des linguistes, ne peut plus être l’adéquation à des pseudo-données objectives. Ainsi, « la dimension L »(4) , dans sa complexité, étant toujours à la fois homogène et hétérogène, la question n’est pas de savoir si, « dans les faits », la diversité linguistique d’un espace quelconque se laisse mieux décrire – de façon exhaustive, non contradictoire et simple – en posant un système de référence unique ou plusieurs systèmes. La question est de savoir pourquoi un individu ou un groupe donné peut se représenter cet espace comme homogène ou comme hétérogène, ce que ces représentations sont susceptibles d’induire, quelles conséquences on peut en attendre. Dans ces conditions, le choix que fait le linguiste de s’engager sur un terrain en mettant en évidence son homogénéité plutôt que son hétérogénéité est une question éthique-politique. Il s’agit de savoir quelles dynamiques il veut exhiber ou occulter, quel rôle il accepte de jouer.
On comprend alors pourquoi Jean-Baptiste Marcellesi fait partie des références théoriques principales de Didier de Robillard. Lorsque l’auteur remarque que « les sociétés seraient partiellement construites par le biais de la dimension L, qui les ferait évoluer également, d’où l’idée que leur être pluriel et complexe est influencé par le L (et réciproquement) » (I-126), on pense à la « double détermination » de Guespin et Ma rcellesi (1986 : 9) :
« Nous sommes conduits à évoquer successivement les deux aspects de l’interaction entre langage et société, mais nous voulons insister sur l’intrication des deux phénomènes : toute société humaine est langagière, et toute pratique langagière est sociale. Ceci a des conséquences pratiques : il ne suffit pas que l’on se donne un objet unique (soit le maintien ou la transformation d’une société conçue comme valeur en soi, sur laquelle on agit par la langue, soit la survie d’une langue elle aussi survalorisée, sur laquelle on agit par pression sur la société). Les principes sont abstraits et fixistes dans les deux cas. La profonde justification de la glottopolitique, ce n’est pas l’alignement de pratiques langagières ou sociales sur un idéal abstrait de langue ou de société ; c’est le développement de la personnalité sociale. »
En réalité, l’approche ontolinguistique recoupe assez largement le projet de la revue Glottopol, du moins tel que je le conçois. Si on admet le postulat glottopolitique selon lequel il est impossible de ne pas intervenir sur la langue et les langues, il s’ensuit que toute description linguistique, aussi « techno » soit-elle, et plus largement toute réflexion à propos de la « dimension L » sont des formes d’intervention, des actes glottopolitiques. Peut alors à bon droit être publié dans notre revue tout texte qui s’intéresse à un aspect de la « dimension L », quel que soit le chemin qu’il prend pour aborder le terrain, dans la mesure où son auteur respecte, en tant qu’agent glottopolitique, des principes éthiques-politiques compatibles avec une démarche « ICH »(5).
Cependant cette position, assez simple sur le plan théorique, ne va pas de soi dans la gestion quotidienne d’une revue ou d’un laboratoire. Comment résister à la pression institutionnelle qui tend à cloisonner les disciplines et les sous-disciplines et pousse le chercheur à s’inscrire dans un champ disciplinaire et un seul ? Comment gérer les contacts et les (dis)continuités entre les disciplines et les sous-disciplines ?
On m’a reproché d’avoir dirigé un numéro de Glottopol consacré aux littératures francophones sous le prétexte que ce n’était pas « de la linguistique » mais « de la littérature ». Lors d’une évaluation que notre laboratoire a subie, à propos de ma contribution à ce numéro (Caitucoli, 2003 : 6-25), un expert a fait remarquer que je m’inscrivais dans le champ de la littérature, ce qui sonnait comme une critique, mais que tout de même je faisais des propositions originales concernant les langues, ce qui justifiait in fine une évaluation positive en tant que linguiste. Le présent numéro, sur le cinéma francophone, suscite des réserves du même ordre. La légitimité de certains articles – à orientation historique ou didactique – a été mise en cause parce qu’ils n’entraient pas dans la « dimension L » par le biais des signifiants, parce qu’ils ne traitaient pas directement du matériau linguistique.
De surcroît, lorsque l’inscription dans le champ des sciences du langage n’est pas discutable, c’est la distinction techno / socio qui peut poser problème. C’est ainsi que Myriam Bouveret, dans sa présentation du numéro 8 de Glottopol (juillet 2006) juge nécessaire d’écrire :
« Un numéro intitulé Traitements automatisés des corpus spécialisés : contextes et sens peut surprendre les lecteurs de la revue Glottopol consacrée habituellement à la sociolinguistique. Il n’est en effet pas question ici de sociolinguistique mais de travaux menés sur corpus par des linguistes et informaticiens. » (Bouveret, 2006 : 1).
Il suffit pourtant d’examiner son sommaire et la présentation qu’en fait Myriam Bouveret pour comprendre que ce numéro respecte le cahier des charges de la revue tel que je l’ai présenté ci-dessus : il y est question de socioterminologie, de veille terminologique, de multilinguisme, de variation, de prise en compte des contextes linguistique et extralinguistique... Nous avons là des contributeurs qui, tout en s’inscrivant clairement dans une épistémologie technolinguistique, ont mené à bien des recherches que je dirai « sociocompatibles », qu’ils en soient conscients ou pas. Tout compte fait, j’ai le sentiment que l’avertissement – en forme d’excuse – de Myriam Bouveret s’adresse moins aux abonnés de Glottopol qu’aux lecteurs spécialistes du traitement automatique des langues et peut-être même à certains auteurs du numéro, qui pourraient s’offusquer de cette excursion de la « LaLinguistique » dans un territoire « socio ».
Le numéro 7 de Glottopol (janvier 2006), consacré aux langues des signes, pose un problème un peu différent puisqu’il juxtapose des travaux technolinguistiques et des travaux sociolinguistiques. Dans sa présentation, Richard Sabria, coordonnateur du numéro, montre bien le sens de l’entreprise :
« Ce numéro de la revue Glottopol s’est ouvert à la présentation de travaux sociolinguistiques et linguistiques afin d’encourager le développement d’études qui se définiraient non pas par la différence des approches mais par la complémentarité de leurs contributions dans la production des connaissances scientifiques sur les LS et leurs locuteurs. Les chercheurs en Sciences du Langage qui partagent le terrain des LS savent que cette position ne relève pas d’une forme d’œcuménisme mais d’une réponse scientifique à la récurrence des effets et processus de minoration que connaissent les LS, en France mais aussi dans le monde. » (Sabria, 2006 : 3).
Il ne s’agit donc pas de tenter un rapprochement de circonstance entre les démarches « techno » et « socio » mais de réaliser une alliance tactique, alliance possible dans la mesure où « l es chercheurs réunis ici partagent, au-delà de la diversité de leurs objets, une ligne éthique et des objectifs » (ibid.).
Peut-on aller plus loin et imaginer des recherches vraiment œcuméniques ? Sur ce point, Didier de Robillard est circonspect :
« Si je me livre à cette petite analyse un peu détaillée, c’est pour mettre en garde certains linguistes œcuméniques qui postulent la complémentarité entre les approches sans aller y voir de près, souvent au nom d’une unité de la discipline parfois un peu inconsciemment sans doute (mais est-ce une circonstance atténuante ?) un peu corporatiste, ou simplement au nom de la coexistence pacifiqu e. (…) Il y a souvent incompatibilité radicale entre ces linguistiques (par exemple entre les linguistiques du code seul et les approches sociolinguistiques). » (II-120-121).
Tout en comprenant ce raisonnement, je crois possible d’envisager des projets clairement ontolinguistiques qui, sans tenter une synthèse artificielle entre des épistémologies contradictoires, iraient tout de même au-delà de l’alliance tactique avec les chercheurs technolinguistes ou de l’exploitation a posteriori de leurs résultats. Louis-Jean Calvet (2004 notamment) me paraît donner des arguments en ce sens lorsqu’il distingue le « pôle analogique » du « pôle digital » et envisage une approche linguistique allant du pôle analogique au pôle digital par un effet de zoom. Je pense aussi au « sablier » de Philippe Blanchet (2000), qui permet d’imaginer trois stades de la recherche : l’exploration, la validation, l’interprétation.
Un travail de ce type prendrait la forme d’un récit de recherche. On y verrait le chercheur, muni d’un ensemble de représentations préalables dont il nous donnerait les sources, livresques mais aussi éventuellement liées à son histoire individuelle, prendre contact avec ses témoins sur le terrain et entrer dans la « dimension L » par « le pôle analogique », avec une démarche empirico-inductive, faisant feu de tout bois et privilégiant l’enquête qualitative. Sa recherche se techniciserait progressivement au fur et à mesure qu’elle passerait du « pôle analogique » et de l’exploration au « pôle digital » et à des procédures de validation, le degré de technicisation dépendant bien évidemment de l’importance de la composante codique pour le sujet traité. Le chercheur pourrait alors, par un retour au « pôle analogique », en s’appuyant sur les résultats obtenus, fournir une interprétation globale des phénomènes et faire le bilan de son parcours de recherche.
La thèse soutenue récemment par Iryna Lehka-Lemarchand (2007) me paraît aller dans le sens de ce programme. Codirigée par David Le Gac (phonéticien, technolinguiste) et moi-même, elle est intitulée : Accent de banlieue. Approche phonétique et sociolinguistique de la prosodie des jeunes d’une banlieue rouennaise. Iryna Lehka-Lemarchand essaie dans cette thèse de mieux comprendre un aspect de la « dimension L » – un phénomène prosodique – en le saisissant dans sa complexité, en tant qu’il est à la fois et de façon indissociable un objet social (pôle analogique) et un objet codique (pôle digital). Il faut dire de plus que le mécanisme qu’elle met en évidence et qu’elle nomme, selon qu’elle travaille dans le digital ou l’analogique, schème accentuel banlieue ou marqueur prosodique banlieue, se prête bien à une approche éclectique : il est assez précis pour être caractérisé de façon fine sur le plan acoustique tout en étant impliqué dans des mécanismes sociaux complexes.
Une expérience de ce type ne va pas sans difficultés.
Une difficulté évidente, lorsqu’on marie les approches techno et socio, réside dans le dosage : dans une thèse codirigée, chaque spécialiste aura sans doute le sentiment que sa spécialité est un peu minorée. Malgré la bonne volonté de chacun, l’expérience d’une codirection techno / socio montre que dans ce domaine comme dans d’autres, l’union est souvent un combat…
Par ailleurs, au-delà des réflexes corporatistes, il y a une difficulté plus profonde : l’alliance des deux approches pose de vrais problèmes de compatibilité épistémologique si le technolinguiste s’inscrit dans un réalisme fort et le sociolinguiste dans un constructivisme radical. Dans ces conditions, l’analyse technolinguistique, positiviste, risque d’être instrumentalisée et quelque peu dénaturée lorsqu’elle est enchâssée dans un projet global à orientation sociolinguistique. En contrepartie, sous la pression des résultats technolinguistiques et de leur force objectivante, l’étude sociolinguistique peut perdre une partie de son inventivité et de sa fraîcheur constructiviste. Dans le cas de la thèse d’Iryna Lehka, le phonéticien pourra juger que la partie technolinguistique n’est pas assez mise en valeur pour elle-même, ce qui n’est pas faux. Le sociolinguiste pourra estimer que l’analyse fait la part belle aux traitements quantitatifs et que l’approche qualitative du terrain n’est pas suffisamment exploitée.
Pour autant, je ne renonce pas à faire converger l’ensemble des moyens dont nous disposons pour mener à bien une recherche. Tout en reconnaissant la légitimité du paradigme constructiviste dans les sciences humaines, je ne vois pas pourquoi les sociolinguistes seraient condamnés à travailler dans le flou lorsqu’ils abordent le domaine digital, pour quelle raison ils se priveraient de certains outils disponibles. Certes il ne faut pas tomber dans le piège tendu par ce que Didier de Robillard nomme le « aïethèque » (I-19) et qui pourrait nous faire croire qu’il n’y a pas de scientificité sans technicité de pointe. Il est effectivement possible de faire de la linguistique « lotèque et non moins intelligente, même et surtout si ce n’est pas de l’intelligence artificielle » (ibid.).
A ce propos, Didier de Robillard se souvient de Francis Jouannet « pendant une escale forcée à la Réunion,commençant dans les salles d’attente de l’aéroport, une esquisse de l’intonation en créole réunionnais et mauricien, en faisant dire des phrases à des locuteurs, et en sifflant ensuite l’intonation pour reconnaître des schémas intonatifs » (II-100). J’ai moi-même pratiqué cette méthodologie « lotèque » en Afrique dans les années soixante-dix – en utilisant une flute indienne car je ne suis pas un bon siffleur – et j’ai obtenu certains résultats. Si je devais aujourd’hui entreprendre une étude de la prosodie d’une langue africaine, je ne renoncerais pas à ma flute mais j’utiliserais aussi les logiciels de détection automatique des paramètres acoustiques actuellement disponibles.
Je m’aperçois, au terme de ce compte rendu, que j’ai passé plus de temps à parler de mes interrogations personnelles que du texte lui-même. Cela me semble lié à une des qualités majeures de l’ouvrage, qui est de susciter chez le lecteur une réflexion sur sa propre pratique plutôt que de le placer – comme beaucoup d’essais théoriques – devant une alternative adhésion / rejet, finalement plus limitée sur le plan intellectuel. C’est que « la recherche, dans un cadre ontolinguistique, consiste en un récit d’expérience que le lecteur / auditeur interprète comme tel » (II-154). Conformément à ce programme, mon compte rendu, lui-même récit d’expérience, tend à être une « traduction / métaphorisation de l’autre pour d’autres » (II-155).
Je recommande à tous ceux qui ne sont pas murés dans leurs certitudes théoriques la lecture de ce texte brillant, souvent provocateur mais jamais dogmatique.
Bibliographie
BLANCHET Ph., 2000, La linguistique de terrain, méthode et théorie, Presses universitaires de Rennes.
BOUVERET M., 2006, « Présentation », dans Bouveret M. (dir.), Traitements automatisés des corpus spécialisés : contextes et sens, GLOTTOPOL n° 8, http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol, pp. 1-5.
CAITUCOLI C., 2004, « L’écrivain francophone agent glottopolitique : le cas d’Ahmadou Kourouma », dans Caitucoli C. (dir.), La littérature comme force glottopolitique : le cas des littératures francophones, GLOTTOPOL n° 3, http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol, pp. 6-25.
CALVET L.-J., 2004, Essais de linguistique. La langue est-elle une invention des linguistes ?, Paris, Plon.
CHOMSKY N., 1957, Syntactic Structures, The Hague/Paris, Mouton.
GUESPIN L., MARCELLESI J.-B., 1986, « Pour la glottopolitique », LANGAGES n° 83, pp. 5-34.
LEHKA-LEMARCHAND I., 2007, Accent de banlieue. Approche phonétique et sociolinguistique de la prosodie de jeunes d’une banlieue rouennaise, thèse de doctorat, université de Rouen.
ROBILLARD D. de, 2007, « La linguistique autrement : altérité, expérienciation, réflexivité, constructivisme, multiversalité : en attendant que le Titanic ne coule pas », dans Blanchet Ph., Calvet L.-J., Robillard D. de, Un siècle après le Cours de Saussure : la linguistique en question, Carnets d’Atelier de Sociolinguistique, n° 1, http//www.u-picardie.fr/LESCLaP/spip.php?article171, http//www.u-picardie.fr/LESCLaP/spip.php?rubrique55, ou dans Blanchet Ph., Calvet L.-J., Robillard D. de, Un siècle après le Cours de Saussure : la linguistique en question, Carnets d’Atelier de Sociolinguistique, n° 1, Paris, L’Harmattan, pp. 81-228.
SABRIA R., 2006, « Présentation », dans Sabria R. (dir.), Les langues des signes (LS) : recherches sociolinguistiques et linguistiques, GLOTTOPOL n° 7, http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol, pp. 2-5.
(1) Le texte auquel j’ai eu accès n’étant pas définitif, les citations et leur localisation dans le texte (tome–pagination) sont données sous toute réserve.
(2) L’ouvrage prolonge la réflexion amorcée dans Robillard, 2007.
(3) Exploitant la terminologie de l’auteur (cf. supra), j’appelle logique « SDH » la logique qui préside à la construction de « Langues Stabilisées-Décontextualisées-Déshistoricisées-Homogénéisées ».
(4) L’expression « dimension L » permet à l’auteur de neutraliser l’opposition langue / discours/ langage.
(5) Une démarche « ICH » est une démarche qui aboutit à la construction de « Langues Instables-Contextualisées-Historicisées-Hétérogènes » (cf. supra).
|
Télécharger cet article : |
format.pdf (152 Ko) |
format.zip (145 Ko) |