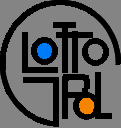
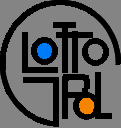
Compte rendu :
Habiba Naffati et Ambroise Queffélec, Le français en Tunisie, n°18 de la revue LE FRANÇAIS EN AFRIQUE, Nice, UMR 6039 (Institut de la langue française-CNRS), 2004, 453 pages, 15 euros (site internet de la revue : http://www.unice.fr/ILF-CNRS/ofcaf/)
par Francis Manzano, CREDILIF (EA 3207) – Université Rennes 2 francis.manzano@uhb.fr
A propos d’un corpus de sociolinguistique maghrébine
Avec Le français en Tunisie est complétée une entreprise de haute valeur scientifique et documentaire entamée il y a une dizaine d’années environ. Avant d’aborder quelques points spécifiques de la Tunisie, on ne peut se passer d’une réflexion plus générale sur la sociolinguistique du Maghreb et les configurations de la Francophonie dans cette partie de la région méditerranéenne et de l’Afrique de l’Ouest, sous peine de perdre plusieurs fils conducteurs nécessaires à la compréhension de l’ouvrage consacré à la Tunisie. La somme de travail fournie par l’équipe plurinationale coordonnée par Ambroise Queffélec à Aix-en-Provence postule justement qu’on porte un regard élevé sur une entreprise qui aura définitivement modifié notre connaissance du Maghreb. C’est un travail de qualité et la barre a été placée très haut.
Un corpus maghrébin. Question préalable : qu’est-ce que le Maghreb ?
Le volume vient en effet à la suite du volume consacré au Maroc (2000) puis à l’Algérie (2002). Il avait eu un volume consacré à la Mauritanie (1998).
Ce premier volume était déjà en soi une originalité. L’évocation de la Mauritanie permet une brève réflexion sur l’identité du Maghreb, ramenée par exemple à cette question : la Mauritanie fait-elle partie du Maghreb ? Pour les Maghrébins, c’est plutôt oui, ne serait-ce que parce que l’arabe lui a donné une langue de superstructure et un rattachement au système radiculaire du Maghreb. Ce rattachement à l’Afrique du Nord (terminologie plutôt française) ou Maghreb (appellation issue de l’arabe) est un fait très ancien et se perd sans doute dans la nuit des temps, en dépassant le seul cas de la Mauritanie. Les fleuves du Sénégal ou du Niger ont toujours constitué l’extremum géographique d’une mouvance arabo-berbère à fondements économiques, commerciaux et coloniaux qui a d’ailleurs donné une forme d’unité « linguistique et bio-géographique » aux régions subsahariennes que nous appelons Sahel, mot provenant de l’arabe et désignant globalement les « rivages » du désert[1]. L’arabe est langue co-officielle en Mauritanie, mais comme il doit partager ce statut avec le français, ici se trouve une rupture fondamentale puisque aucun pays d’Afrique du Nord stricto sensu (Maroc, Algérie, Tunisie) n’a donné, depuis les indépendances respectives, un tel statut au français. Si j’évoque le cas de la Mauritanie, qui ne semble pas en rapport direct avec la Tunisie, c’est bien parce qu’il existe deux définitions du Maghreb : d’abord celle d’un Maghreb « restreint » ou Afrique du Nord dans la tradition française (Maroc, Algérie, Tunisie, où l’on reconnaît une colonie et deux protectorats de la France), ensuite celle d’un Maghreb étendu se rapprochant alors le plus possible de cette mouvance « arabo-islamique » d’Afrique du Nord-Ouest (mais où est la place des Berbères dans ce projet ?) qui, de l’Egypte occidentale aux deux boucles du Sénégal et du Niger (voir plus haut) constituerait une sorte d’optimum ou « Grand Maghreb »[2].
A cet égard, le rattachement de la Mauritanie au corpus maghrébin paraît une sage décision, qui pourrait s’avérer très heuristique par ailleurs dans l’avenir[3]. Mais ce type d’approche ramène à deux problèmes connexes qu’il faut encore poser. Que faut-il faire de la Libye ? C’est là une composante reconnue du Maghreb « arabo-islamique » mais soigneusement tenue à l’écart du bloc « français » (XIXe et XXe) et toujours marginalisée, il faut bien le dire, quelles que soient les raisons de cette marginalisation. Mais également (plus grave encore à certains égards), pourquoi laisser dans l’ombre l’île de Malte ? Cette dernière est certes totalement dissociée du Maghreb « arabo-islamique », mais elle est jusqu’à nouvel ordre un petit canton du Maghreb linguistique, au moins autant que la grande Libye, et dont la connaissance est très importante pour la Tunisie dont nous allons parler[4]. On pourrait m’objecter que ces deux secteurs géographiques de Malte et de la Libye s’extraient eux-mêmes de la zone francophone et que les questions ici évoquées ne se posent donc pas. A mon sens, un tel point de vue réducteur, formaté par nos traditions européennes et coloniales, n’a pas grand chose à voir avec les nécessités de la linguistique. Car il faudra bien tôt ou tard que les linguistes aient enfin l’audace d’aborder et d’intégrer dans leurs raisonnements ces deux chaînons manquants, comme l’équipe de Queffélec l’a fait pour la Mauritanie. Certes la démarche ne paraît pas à première vue directement liée à la francophonie, mais nous aurions en effet tout à gagner de travaux sur les contacts entre langues européennes autres que le français et langues chamito-sémitiques dans cette partie médiane de la Méditerranée. C’est une de ces zones d’ombre et de non-dits sur laquelle devront porter de nouveaux efforts.
Pour finir, dans ce Maghreb à géométrie variable, on ne perdra pas de vue que la Tunisie constitue un centre géographique (du « grand Maghreb ») et symbolique (de la Méditerranée dans son ensemble), toujours à mi-chemin d’une mouvance et d’une autre. C’est l’ancienne « Africa » des latins, « Ifriqiya » des Arabes, le lieu même où ces derniers affrontèrent et défirent pour la première fois Byzantins et Berbères au VIIe siècle, une entrée, un verrou historique du Maghreb. Sans doute est-il normal que ce pays, pour des linguistes, des historiens, des anthropologues, mérite une attention très particulière.
Méthodes et résultats
Le principe d’auteurs multiples adopté par la collection entamée en 1998, qui aurait pu déboucher sur une certaine dispersion de l’ensemble, conduit au contraire à éclairer les faits de langue au Maghreb de manière intelligible et dans un esprit de complémentarité très nouveau dans cette zone géopolitique. La méthode de travail adoptée au sein de l’équipe animée par Ambroise Queffélec est l’une des explications principales de cette unité profonde. Depuis une dizaine d’années en effet les rencontres d’harmonisation technique et de méthodologie lexicographique ont été croisées avec plusieurs temps forts de réflexion sociolinguistique ayant réuni (à Aix-en-Provence notamment) des partenaires de l’ensemble du Maghreb. Cette pratique dynamique et fédératrice a conduit des chercheurs originaires du Maroc, d’Algérie et de Tunisie notamment à se retrouver régulièrement, à échanger, et prendre ainsi conscience de nombreuses problématiques communes à travers des situations que nombre d’entre eux vivaient souvent (par la force des choses) comme propres à leur pays d’origine. Il faut en effet souligner que la circulation horizontale des informations scientifiques (c’est-à-dire d’un pays du Maghreb à l’autre) était très faible dans les années 1970 à 1980, pour des raisons bien souvent politiques liées aux structures des Etats maghrébins, mais aussi pour des raisons liées à la configuration verticale des structures de la coopération scientifique et culturelle française, relativement massive encore à cette époque dans l’enseignement supérieur. L’ensemble de ces conditionnements tendait évidemment à isoler les chercheurs et à les ramener à des matrices locales d’interprétation des faits, condamnant par exemple la plupart des études relatives à la francophonie à cadrer de facto avec un principe d’affrontement binaire diglossique tendu du français et de l’arabe (hérité directement de la décolonisation), posant à peu près constamment le français comme « langue étrangère », ignorant par ailleurs souvent la question du berbère ou des autres langues romanes présentes au Maghreb, ce qui n’est pas rien dans cette partie du monde où les contacts et interpénétrations entre familles de langues sont pluriséculaires. Dans tous les ouvrages déjà publiés par le groupe en question, dans toutes les réunions de travail, ce souffle nouveau s’est fait sentir et des portes se sont peu à peu ouvertes. Gageons que cet état d’esprit, encore une fois nouveau au Maghreb, sera une mine de progrès pour la recherche linguistique bien entendu, mais aussi plus fondamentalement pour le bien-être des sociétés maghrébines.
Cette série de travaux, même si les éditeurs ont changé en cours de route, comporte toujours un volet sociolinguistique général très solide et documenté, bien que l’on centre par principe sur le français : langues en présence dans le pays et relations identitaires, matériaux relatifs à la diffusion historique du français, usages contemporains du français etc. Un deuxième grand volet est le résultat d’un inventaire lexicographique au sein de productions francophones clairement identifiées : presse nationale, littérature, essais, ouvrages spécialisés. A la sortie : un corpus toujours documenté, même s’il faut lui assigner des limites, qui sont celles de l’écrit, car l’écrit francophone (bien que très représentatif) ne sature pas pour autant les productions francophones locales. Ajoutés les uns aux autres, ces corpus régionaux constituent désormais un trésor de lexies « franco-maghrébines » que l’on affinera certainement par la suite, mais qui permettront sans doute, pour la première fois dans l’histoire du Maghreb me semble-t-il, des travaux d’ampleur sur la dynamique des univers lexicaux maghrébins filtrés par la langue française.
Un vent de nouveauté souffle également sur les informations bibliographiques. Il est là aussi lié aux méthodes de collecte adoptées, car on s’est toujours appuyé dans cette entreprise sur des recensements très sérieux, sur des mises en commun d’informations, voire sur du bouche-à-oreille, ce qui a conduit différents chercheurs à faire connaître leurs travaux, même de faible diffusion, voire inédits. Un exemple, que j’aimerais souligner pour illustrer cette force. Dans mes propres réflexions sur le Maghreb, j’ai beaucoup insisté sur la présence (et l’influence) continue des langues romanes au Maghreb et en Algérie par exemple, non sans éléments déjà apportés par des études anciennes, généralement oubliées. Il est d’autant plus intéressant que dans le volume consacré à l’Algérie (2002) soient mentionnés les travaux (à ce moment inédits) de L. Benallou confirmant le poids lexical et l’ancienneté des apports de l’espagnol dans les parlers arabes de l’Oranie.
Plus généralement, cette démarche intelligente d’élargissement des informations a conduit de proche en proche à un inventaire bibliographique très solide, ce qui fournit désormais une toile d’informations récupérables d’une section sur l’autre, comme pour des recherches à venir.
Pour achever cette introduction, il faut souligner qu’avec un corpus rigoureux de plus de 1500 pages, riche d’informations et de problématiques, on dispose d’une base de données qui n’a jamais existé jusqu’à présent au Maghreb. Ce n’est pas la moindre des qualités d’une entreprise qui deviendra probablement un classique de la sociolinguistique maghrébine de demain, en tout cas une base indispensable pour de futures études.
Le cas tunisien
Je ne ferai pas un commentaire détaillé des qualités ponctuelles, voire des défauts que l’on peut estimer voir ici ou là. En revanche, il me paraît très important alors qu’un cycle de publications synthétiques s’achève sur ce volume de la Tunisie, de procéder à une réflexion d’ensemble sur la francophonie du Maghreb et particulièrement celle de la Tunisie, qui s’alignera sur nombre d’arguments que l’ouvrage donne et que le lecteur aura le plaisir de découvrir par lui-même.
Avec Le français en Tunisie, les dimensions historique et sociolinguistique, déjà très sensibles dans le volume consacré à l’Algérie sont clairement assumées dès la première partie de l’ouvrage (Configurations sociolinguistiques et linguistiques, 114 pages). Notamment au chapitre 1 : « Les origines du plurilinguisme tunisien », ce qui pourrait paraître important pour des raisons simplement documentaires, c’est-à-dire si l’on ne veut pas « raboter » les composantes diverses pour les ramener à un schéma consensuel un peu trop simplifié de type diglossique (français vs. arabe). Mais il y a plus. L’ouvrage porte bien une idée centrale qui est celle d’un plurilinguisme très ancien dans cette partie du Maghreb (notamment coexistence de langues romanes, du berbère et de l’arabe) ayant favorisé, voire préparé, les contacts modernes observés depuis le XIXe siècle. En quelque sorte, la disposition géo-historique de la Tunisie l’aurait située très tôt à un carrefour identitaire et sociolinguistique qui semble avoir pétri en profondeur des personnalités collectives particulièrement aptes aux bi et plurilinguisme, voire au syncrétisme sociétal et culturel. Il n’est pas interdit d’élargir cette façon de voir à l’ensemble de l’Afrique du Nord où deux pays ont la réputation d’être particulièrement francophones : l’Algérie et la Tunisie. Certes, il n’est guère possible de passer au tamis cette affirmation assez générale dans le cadre étroit d’un compte rendu. Cela paraît pourtant globalement vrai, mais pour des raisons différentes que je souhaite souligner en quelques mots. Nul doute que le fait que l’Algérie ait été colonie française a contribué à largement décaper l’implantation originelle de l’arabe (variétés hautes, institutions etc.) et, par le biais d’un quadrillage administratif et scolaire à la française, à implanter au contraire le français dans les points les plus reculés du pays [5] . Cela est connu, mais pas assez creusé. Comme je l’ai rappelé ailleurs (Langage et société, 1996), la scolarisation républicaine au pas de charge de la fin du XIXe s’est tout simplement transplantée et adaptée en Algérie. Cette caractéristique historique fondamentale du paysage algérien, dès lors qu’elle a été ensuite confortée par une progression avérée de la scolarisation générale, conduit au fait (toujours très étrange à première vue par rapport au cas marocain, voire au cas tunisien) qu’on retrouve des francophones spontanés dans différents milieux sociaux, différentes régions géographiques et différentes classes d’âge (ce qui, évidemment, tend à s’estomper chez les plus jeunes). Certes le Maroc et la Tunisie ont également connu une véritable politique de francisation (voir le chapitre 2 : « Le protectorat et la politique de francisation », et l’importance du « collège Sadiki »), mais dans le premier cas (Maroc) il est assez aisé de constater que le français n’a guère touché historiquement les campagnes et les classes populaires restées fondamentalement berbérophones, arabophones, ou diglottes (arabe-berbère). Dans ce pays toujours, et en apparence de manière paradoxale, ce n’est qu’assez récemment (depuis les années 1950-1960 notamment) que le français est arrivé au peuple, par la scolarisation surtout (mais il s’agit aussi d’un français fragile, souvent superficiel, fragmentaire, en tout cas rarement « approprié »). Au Maroc donc, plus qu’en Algérie et qu’en Tunisie et toutes proportions gardées, le français reste un signum d’élite.
De ce point de vue, s’il est vrai qu’existent en Tunisie les preuves sociologiques d’une francophonie « haute », il est très évident qu’il existe aussi une francophonie bien plus diffuse, celle de la rue, sympathique et directe, ce qui rejoint une réflexion capitale et présente dans ce livre : l’appropriation (voir chapitre 5, « Le conflit linguistique et identitaire », pages 52 à 56). Certes, tout le monde ne parle pas français dans ce pays, mais aucune chance d’y trouver des communautés locales entièrement monolingues, comme on en trouve toujours à l’autre extrémité, dans l’Atlas marocain notamment. Et c’est précisément pour comprendre ce phénomène patent qu’il faut disposer d’un cadre d’interprétation large. Je dirais volontiers, en raccourci, que la Tunisie aurait pu (aurait dû) tout aussi bien parler italien, parce que la proximité du chapelet d’îles (Malte, Sicile) et de l’Italie, et les contacts constants avec ce secteur de la Romania, comme la pénétration scolaire avérée de l’italien au XIXe siècle la préparaient à cela[6]. Mieux encore : de toute manière, la Tunisie aurait été de facto toujours partiellement romanophone, parce qu’il s’agit là d’une constante de son fonctionnement sociolinguistique diachronique. Il se trouve que l’impérialisme français, à la fin du XIXe, a bloqué ses concurrents (voir aussi le cas de l’Espagne, pour le Maroc et l’Algérie), ce qui a ensuite permis l’installation et la diffusion massive de cette langue ; Mais sur un terrain (je me répète à dessein) qui, pour avoir entretenu régulièrement cette composante ou affinité romane a toujours été « prêt », une ou plusieurs langues romanes modernes auraient d’une manière ou d’une autre charpenté une partie des constitutions identitaires et des schémas communicatifs modernes.
A cette base définitoire s’ajoutent d’autres caractéristiques qui permettent de comprendre la typologie propre de ce laboratoire sociolinguistique original que constitue la Tunisie. La taille du pays tout d’abord, qui minimise les variations diatopiques (c’est le plus petit pays du Maghreb traditionnel). On distingue parfois un « arabe tunisien du nord » (polarisé notamment sur la conurbation de Tunis) relativement distinct d’un « arabe tunisien du sud », c’est du moins ce qui ressort de différentes informations recueillies au cours d’enquêtes épilinguistiques. Mais l’un dans l’autre l’homogénéité de l’arabe tunisien paraît bien plus nette que celle de l’Algérie, ou que celle du Maroc, où par exemple le parler arabe des Oujdi (région d’Oujda) est assurément plus éloigné de l’arabe d’Essaouira ou de tel autre point de l’Ouest que le parler de Sfax n’est éloigné de celui de Tunis[7]. Deuxième trait, qui renforce cette homogénéité : l’exiguïté de la composante berbère, arrivée probablement à la phase terminale. J’ai eu l’occasion d’insister à plusieurs reprises sur cette particularité tunisienne, portant notamment un regard sur les dernières positions ce cette langue à Djerba dans les années 1990. Avec 1 % environ des locuteurs pour le berbère, la Tunisie est le premier pays du Maghreb à se trouver en voie de sortir d’un système tripolaire qui a longtemps caractérisé cette région de la Méditerranée ; mais de cette nouveauté « prochaine » on ignore ce qu’il sortira, alors que le système tripolaire fonctionne toujours très bien en Algérie et au Maroc, tendant par définition à favoriser une sorte de statu quo sociolinguistique. Il est certain que ces principes d’unification, alliés à l’enracinement des contacts romans, ont pénétré en profondeur la conception de la langue que se font les Tunisiens, et donc les axes d’évolution probable du système sociolinguistique. A travers un état d’esprit souvent très proche (mais probablement pour des raisons et par des cheminements différents) de l’état d’esprit français, les locuteurs tunisiens paraissent particulièrement tournés vers l’unification au détriment des particularismes. Cet état d’esprit, qu’il faudrait mettre en rapport avec différents autres facteurs (importance du tourisme et des flux étrangers, immigration Tunisie-France, très haut taux de scolarisation – le plus élevé d’Afrique du Nord –) avantage donc en même temps l’arabe (composante arabo-musulmane de l’identité) et le français, qui se présente ainsi comme la composante romane « normale » et unitaire de l’identité tunisienne.
Une idée reprise en plusieurs endroits est celle d’une relative souplesse du système sociolinguistique. Alors que dans le pays voisin (Algérie), par exemple, c’est la tension qui domine (tension de l’Etat et des politiques linguistiques, mais aussi tension « interne », c’est-à-dire partage, difficulté, à l’intérieur de chaque locuteur-informateur), ce qui caractérise la Tunisie est effectivement le caractère « a-passionnel » du marché linguistique, un caractère qui doit certes beaucoup aux deux régimes politiques successifs depuis l’Indépendance, mais au moins autant aux bases historiques évoquées plus haut.
Il ressort que le « conflit linguistique et identitaire » (voir chapitre 5), qui remonte par soubresauts dans l’Histoire moderne du pays, est pourtant résolu le plus généralement de manière positive et sans tension, comme on peut le lire à la page 53 :
« De manière générale, bien que le comportement varie selon les individus et les périodes, le Tunisien, en comparaison avec d’autres Maghrébins, ne rejette pas farouchement la culture française. Le métissage est bien réel : métissage des valeurs (orientales et occidentales), métissage des langues (arabe et français). »
Dans les chapitres 6 et 7 sont présentées de manière très synthétiques de très bonnes caractérisations des locuteurs francophones de Tunisie, tant dans les paramètres sociaux que dans ceux de l’âge et du sexe, ainsi qu’une réflexion complète sur les contextes d’emploi de la langue française. Sur la question du sexe par exemple, différents observateurs de la société tunisienne ont remarqué dans leurs travaux la tendance très nette des femmes tunisiennes à adopter le français avec facilité. Les auteurs du livre rapprochent à juste titre cette tendance d’une tendance plus générale reconnue par la sociolinguistique, qui observe que les femmes tendent régulièrement vers les variétés prestigieuses. J’ajouterai ici que ce phénomène avait été reconnu par différents dialectologues romanistes de France dès le début du XXe siècle, lesquels s’étaient rendu compte que les femmes étaient un agent évident de francisation linguistique des campagnes patoisantes. J’ajouterai aussi qu’il doit probablement exister une relation entre ce positionnement sociolinguistique préférentiel des femmes et leur statut socio-politique plutôt exemplaire en Méditerranée et dans le monde arabo-musulman.
Au chapitre 8 est tentée une caractérisation du français de Tunisie par paliers, en allant du basilecte (très instable et caractérisé par différentes approximations résultant ou du substrat ou d’un principe de simplification) à un acrolecte reconnu mais d’une vitalité réduite. Entre les deux, une zone mésolectale sature la plupart des productions tunisiennes. Bien sûr, comme ailleurs au Maghreb, les phénomènes d’alternance codique jouent un rôle très important et il semble très juste de les envisager dans le cadre d’une vision globale de productions où l’on se sert du français et de l’arabe comme « marqueurs » de choses très diverses : appartenance, identité, répulsion, attraction etc.
Le principe d’introduction de résultats d’étapes (travaux en cours, inédits ou mal diffusés) est toujours appliqué. Un exemple significatif (pages 54-55), celui de l’enquête de Leïla Bel-Hadj Larbi (1995), visant à préciser les positionnements identitaires d’une population d’élèves de l’enseignement secondaire (17-18 ans). Les résultats de cette enquête présentent l’avantage de pouvoir être confrontés à ceux qu’obtenait un quart de siècle plus tôt Zohra Riahi, dans un article fameux (1970)[8]. Ils paraissent montrer dans l’ensemble que les jeunes gens assument de mieux en mieux le principe d’une identité tunisienne en quelque sorte « pluriculturelle », bien que ce terme ne soit guère satisfaisant. Il n’est semble-t-il plus question « d’embarras » comme en 1970, mais en revanche les jeunes gens paraissent conscients du fait qu’un mauvais enseignement (et donc une mauvaise acquisition) du français tend à les rejeter de facto vers une monoappartenance au tronc arabo-musulman. Les Tunisiens, et c’est en cela probablement qu’ils sont en passe de devenir vraiment exemplaires en Méditerranée (la position des « jeunes » est donc cruciale), paraissent ainsi de moins en moins considérer comme contradictoire l’appartenance aux deux ensembles majeurs « arabo-musulman » d’une part et « occidental » de l’autre, bien qu’une pression très forte s’exerce ici comme ailleurs en direction d’un cadrage arabo-musulman dont les nébuleuses fondamentalistes ne sont que l’une des manifestations les plus apparentes.
Les chapitres 9 à 11 reviennent sur la méthodologie de l’inventaire lexical, sur l’analyse sémasiologique et onomasiologique du corpus. Comme dans les volumes précédents, il s’agit d’éléments de cadrage rigoureux qui soulignent bien la créativité (en fait souvent méconnue) de cette francophonie. Une francophonie tunisienne qui par ses néologismes ou les transferts de l’arabe (voire du berbère) au français qu’elle assume pleinement, vérifie bien ce qui est dit plus haut de l’appropriation du français.
Il serait artificiel de commenter en particulier ces différents chapitres. Je préfère pour ma part terminer en montrant rapidement comment le corpus créé est à même de relancer des réflexions sociolinguistiques qui seront certainement nombreuses. Je choisis un article court, mais aussi très représentatif de relations plusieurs fois évoquées dans le livre et le compte rendu.
Rounda, ronda (probablement de l’italien et/ou de l’espagnol) n. f.
Disp[9]. Jeu de cartes. Un danger qui ne cesse de s’accroître
surtout durant la morte-saison ; celui, si j’ose dire, des « enragés
de Chkobba »[10],
« Rounda » et « Bligou ». Tels sont les différents jeux
possibles des 40 cartes connues en Tunisie sous le nom de « Karta ».
(Dialogue, 15/3/76).
La fête était finie, le
grand escogriffe partait tous les matins sur son vélo, il sentait la sciure et
la colle à bois, il ne buvait pas, fumait des cigarettes informes, à peine se
payait-il une partie de ronda [jeu de cartes] avec ses amis le vendredi soir. (Bécheur, 1996, 104).
Tel quel, l’article peut sembler relativement « neutre » et précis, ce qui constitue en soi un apport déjà appréciable. Voici donc une lexie qui existe vraiment car elle s’intègre aux productions françaises comme elle s’intègre également aux productions arabes, les exemples pris le montrent. Mais je voudrais prolonger le commentaire lexicographique historique vers l’interprétation globale qu’il autorise.
Il y a beaucoup de choses sous la plume d’Ali Bécheur. Impossible de se borner à la surface du texte sans quoi la « ronda » perd toute sa puissance, son pouvoir éclairant. La scène se déroule au soir du jour de relâche et de prière, la semaine est finie, et l’on revoit aussitôt tous les cafés du Maghreb, les verres de café ou de thé fumant, les tablées d’hommes serrant et cachant leurs jeux usés, malaxés par des milliers de mains, les abattant avec fougue et bruit sur la table de formica où les chevaliers, les glaives, les massues, les « escudos » sont ensuite rapidement raflés par le vainqueur. Ce qui veut dire en fait qu’un mot (et un jeu) comme « ronda » illustre à peu près toutes les étapes de l’intégration. Sans doute parti de l’espagnol et passé en Italie par le biais des impérialismes horizontaux de l’Espagne et de la Catalogne au Moyen Age (mais il est vrai que ronda « ronde » est autant espagnol qu’italien ou catalan) le mot est entré dans la langue arabe en même temps que le jeu est entré au plus profond de la culture tunisienne, puisqu’il en est au fond l’une des caractéristiques les plus prégnantes. Et il passe pour finir en français comme porteur non tant d’une identité romane (qui se fond) que d’une identité-spécificité tunisienne. Celle-ci, on l’aura compris, n’est ici qu’un cas particulier d’une identité maghrébine et méditerranéenne où il faut espérer que, longtemps encore, la « ronde » se poursuive.
Bibliographie
Benzakour F., Gaadi D., Queffélec A., 2000, Le français au Maroc. Lexique et contacts de langues, Louvain-la-Neuve, De Boeck-Duculot-AUPELF.
Brondino M., 1980, Le Grand Maghreb, mythe et réalités, Alif-Editions de la Méditerranée, Tunis. Version originale en italien : 1988, Il Grande Maghreb : Mito e Realtà, Université de Pavia.
Manzano F., 1996, « Sur les mécanismes du paysage sociolinguistique et identitaire d'Afrique du Nord », Langage et Société, 75, mars, pp. 5-44.
Marçais P., 1977, Esquisse grammaticale de l’arabe maghrébin, Maisonneuve, Paris.
Naffati H., Queffélec A., 2004. Le français en Tunisie, LE FRANÇAIS EN AFRIQUE, n° 18, Nice, UMR 6039 (Institut de la langue française-CNRS).
Ould Zein B., Queffélec A., 1998., Le français en Mauritanie, Paris, AUPELF-Hachette-EDICEF.
Queffélec A., Derradji Y., Debov V., Smaali D., Cherrad-Bencheffra Y., 2002, Le français en Algérie. Lexique et dynamique des langues, Louvain-la-Neuve, De Boeck-Duculot-AUF.
Riahi Z., 1970, « Emploi de l’arabe et du français par les élèves du secondaire », dans Quelques aspects du bilinguisme en Tunisie, Cahiers du CERES, Série linguistique, 3, pp. 92-166.
[1] Puisque nous évoquons plus loin la Tunisie, on rappellera que l’appellation Sahel s’y applique cette fois à la région littorale au sud de Sousse.
[2] Je signale sur ce point un excellent ouvrage permettant de faire le point en élargissant les perspectives : Michele Brondino, 1990, Le Grand Maghreb, mythe et réalités.
[3] Soulignons qu’en Mauritanie sont en contact le français et l’arabe, mais aussi le berbère et différentes langues négro-africaines (originalité supplémentaire des corpus mauritaniens).
[4] A ces points de vue s’en opposent d’autres, il faut le rappeler. Celui par exemple de certains arabisants. Pour Philippe Marçais (1977), par exemple, le bloc Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, constitue un ensemble « relativement homogène. Aussi bien en a-t-on délibérément écarté Malte et la Mauritanie, jugées vraiment extérieures, à divers points de vue, à cet ensemble cohérent ».
[5] Dans le même temps c’est ce décapage qui peut expliquer pour l’essentiel la production ultérieure d’une diglossie frontale tendue et stérilisante arabe vs. français dont l’Algérie en particulier et par ricochets le Maghreb dans son ensemble, ont, ou ont eu, le plus grand mal à sortir.
[6] Un phénomène que j’ai souligné dans la revue Langage et Société (1996) et détaillé ici, pages 14 à 16. Dans le même ordre d’idée, l’ouvrage rappelle qu’un journal en italien existait encore dans les années soixante (p. 37).
[7] Malheureusement, la dialectologie arabe d’Afrique du Nord a longtemps été bloquée par des facteurs mentaux ou politiques lourds qui rendent difficile la reconnaissance des variations dialectales et, à plus forte raison, quadrillages du territoire et mesures linguistiques.
[8] Cet article faisait partie d’un ensemble de travaux de type sociolinguistique qui marquent historiquement la réflexion des linguistes tunisiens.
[9] Signifie « disponible ».
[10] Chkobba est lui-même d’origine romane (< it. Scopa, jeu de carte), comme karta et vraisemblablement pligou (cf. catalan plegar « plier »), voir le lien avec fr. pli < Plier.