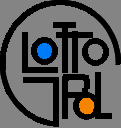
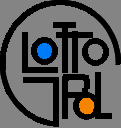
| Léglise I., Canut E., Desmet I., Garric N. (dirs.), 2006, Applications et implications en sciences du langage, Paris, L'Harmattan, 334 p., ISBN 2-296-02743-5 par Didier de Robillard (E.A. 4246 DYNADIV - Université François-Rabelais Tours) |
De l’art difficile du compte rendu
A-t-on le droit de faire un compte rendu lorsqu’on est fondamentalement en désaccord avec l’approche d’un ouvrage (Robillard, 2007, 2008) ? Evidemment oui, même si cela met sans doute tout le monde dans une situation inconfortable, puisque nous préférons tous le consensus, la paix et l’harmonie, alors que nous savons bien que ce qui nous permet complexifier notre vision, dans notre activité professionnelle de chercheurs, c’est le débat, et bienveillant, et sans concession. Si le débat est le nerf de l’activité scientifique, on a même le devoir de faire un compte rendu dans ces conditions, puisque cela apporte sans doute plus de carburant à notre activité que soit un compte rendu factuel, soit un compte rendu « adhésif ». Néanmoins, éthiquement, cela nécessite une clarification initiale, qui est maintenant faite. J’expose plus bas, pour les nombreux lecteurs qui ne connaissent pas mes positions théoriques (Robillard, 2007, 2008), un résumé de celles-ci pour éviter d’encombrer le début de ce compte rendu.
Je voudrais commencer par mettre le lecteur et les contributeurs de ce volume à l’aise : si je peux tenir un discours dont je pense qu’il peut être utile sur le contenu de ce volume, c’est aussi que j’ai éprouvé nombre des difficultés qui seront évoquées plus bas pour les avoir ressenties personnellement, et pour avoir mis en œuvre certaines des stratégies d’évitement décrites infra, et y avoir réfléchi postérieurement, en cherchant des issues, ce qui, après de longues années, m’a conduit aux considération résumées en annexe, et tenues ici plus bas. Il y a une dizaine d’années, j’aurais sans doute adhéré beaucoup plus aux positions exprimées dans l’ouvrage dont je fais le compte rendu.
Il faut rajouter à cela que, contrairement à ce qui est la position généralement considérée comme « normale » dans une épistémologie positive, je ne revendique pas la position d’expert surplombant. La position d’expert va de pair avec l’idée que le chercheur « contrôle » son « objet », posture qui est caractéristique du paradigme expérimentaliste, auquel je n’adhère pas. Dans ce cas, il adopte donc une position de « surplomb », et, s’il fait de l’épistémologie, se place en surplomb par rapport aux praticiens de la discipline dont il fait l’épistémologie. Je ne peux pas m’étendre ici dans le détail (Robillard, 2007, 2008) : j’argumente(1) l’idée que, en sciences humaines, quelles que soient les médiations interposées (éventuellement les plus expérimentales et déshumanisantes), on tient, en fin de parcours, un discours historicisé, contextualisé, sur d’autres êtres humains, en prenant ses responsabilités face aux effets envisagés de ce discours, tout en sachant que tous les effets n’en sont pas prévisibles. Cela ne signifie pas, comme le voudrait la version édulcorée des approches interculturelles et de l’altérité, que l’on renonce au conflit, mais que l’on essaie de faire du conflit constructif (que l’on fait et l’amour, et la guerre, pour pasticher un slogan célèbre). On aura compris que l’avis qui sera explicité plus bas, loin de concerner seulement l’ouvrage dont il est fait un compte rendu, concerne plus largement la linguistique dans son ensemble. J’ai déjà eu l’occasion de donner mon avis sur cette question (Robillard, 2007) en me promettant de récidiver (Robillard 2008). Ce point de vue majoritaire se voit exemplifié cette fois dans un ouvrage qui a le mérite, rare, de réunir à la fois un ensemble de travaux assez diversifiés de linguistique, et( de concerner majoritairement des jeunes(2) chercheurs, donc l’avenir de notre activité.
Des travaux de qualité
Je ne peux pas donner un avis autorisé sur le fond de l’ensemble des articles de cet ouvrage par manque de compétence dans tous les domaines couverts. Cependant, dans les secteurs qui ne me sont pas étrangers, je suis admiratif de discours produits sur l’« autre parlant(3) », par exemple dans le domaine de la sociolinguistique, celui que je connais le mieux. Même si je ne pourrais sans doute argumenter que plus malaisément face aux autres domaines représentés dans cet ouvrage, il me semble que dans ces secteurs, la même qualité est présente, ce qui ne manquera pas d’intéresser le lecteur de cet ouvrage, quel que soit son centre d’intérêt.
Cependant, si l’on garde à l’esprit tant le titre de l’ouvrage que son « Introduction », ce n’est pas là l’ambition première de cet ouvrage, et je vais donc m’engager sur ce terrain essentiel, qui fait la grande originalité de ces travaux et le mérite de cet ouvrage.
Mettre résolument les pieds dans le plat
Il faut commencer par féliciter les initiatrices de la réunion qui a donné lieu à la publication de ces actes de colloque, d’autant plus qu’elles en sont aussi les éditrices. En effet, cet ouvrage collectif a l’immense mérite d’aborder une question assez largement négligée par le passé et par la majorité des linguistes (Léglise & Robillard, 2003 ; Gadet, 2005). Il s’agit de celle de l’articulation entre les travaux scientifiques de la discipline « Sciences du langage » et les préoccupations des citoyens en général (et cela a des retombées manifestes sur les débouchés professionnels des étudiants en sciences du langage, et donc sur la pérennité de la discipline). En effet, même si nombre de collègues se sont préoccupés de ces questions à titre individuel, qui en s’investissant dans les préparations aux concours d’entrée dans l’éducation nationale, qui en travaillant dans les IUFM, qui en militant dans des associations, qui en effectuant des recherches sur la parole au travail, les migrants, etc., il n’en demeure pas moins rare de rencontrer un ouvrage très explicitement consacré à ces questions, et revendiquant que cette réflexion fait partie légitimement du travail de linguiste (et ne doit donc pas être laissé à d’hypothétiques épistémologues qui viendraient s’intéresser à la linguistique(4)), risque, et donc courage supplémentaire qu’il faut saluer et encourager, en réclamant de nombreuses récidives.
Ce constat n’est pas anodin, car se préoccuper de ces questions est souvent considéré comme d’un d’intérêt « scientifique » accessoire, secondaire(5), et nous voilà au cœur du sujet. Une telle attitude repose, implicitement, sur l’idée que la « vraie » science est fondamentale, et ne se préoccupe que peu de la professionnalisation des étudiants, etc., préoccupations laissées à ceux et celles qui, réputés n’ayant rien de plus déterminant à écrire sur la science fondamentale, se consacreraient à ces intérets ancillaires.
C’est pourquoi je tiens donc à féliciter les contributeurs à cet ouvrage d’affirmer, en y participant, que ces questions sont centrales, et il est important de les congratuler d’autant plus que ces questions sont risquées, et qu’il appartiendrait au moins autant qu’à des jeunes chercheurs, à des chercheurs chevronnés de travailler ces questions (mais ceux-là sont assez rares, serait-ce parce que la question de leur professionnalisation à eux ne se pose plus ?). En ce sens, cet ouvrage est un constat implicite sévère sur le passé, et un espoir pour l’avenir puisque ce sont des jeunes chercheurs qui s’y consacrent, et le lecteur ne pourra qu’en tirer un grand profit. Mais il faut s’assurer que ces jeunes chercheurs, lorsqu’ils auront été recrutés, continueront à se poser ces questions malgré cela, ce qui est le cas d’une partie des participants ce volume.
Je poursuivrai donc, enhardi par le courage de nos jeunes doctorants et collègues, en suggérant que si les sciences du langage (mais on pourrait en dire autant d’autres disciplines des sciences humaines et sociales) ne s’étaient pas frileusement enfermées loin des courants épistémologiques nouveaux (même si cet adjectif est un peu excessif, les travaux mettant en doute la physique newtonienne et le prédictibilisme datent du premier quart du 20 ème siècle) et loin des travaux sur l’histoire de leur discipline (Auroux, 1994), il est probable que les sciences du langage auraient une tout autre allure au début du 21 ème siècle, au moment de célébrer le centenaire de la publication du Cours de linguistique générale. En effet, cet ouvrage ouvre, précisément, cette parenthèse, qui est peut-être en train enfin de se refermer, et qui a considérablement restreint les centres d’intérêt des SDL, en les précipitant dans le marasme(6) qui est le leur depuis des décennies (Blanchet, Calvet, Robillard, 2007). Dans la mesure où les critiques que l’on pourrait adresser à de jeunes doctorants et collègues nous concernent tous, il me semblerait injuste de pointer du doigt quelques individus, ce que je ne ferai donc pas dans ce compte rendu. Cela serait d’autant plus malséant que ces individus, sont précisément ceux qui se marginalisent en combattant le mal : les mettre au pilori alors qu’ils sont le produit d’un processus qui concerne la majorité des linguistes serait inconsidéré. Pour cette raison, lorsqu’il m’arrivera d’être critique, je citerai rarement directement de cet ouvrage, en tout cas pas les jeunes chercheurs en pleine évolution qui y publient un article, qu’il ne faudrait pas figer ainsi dans une posture, sans aucun doute, pour eux, transitoire. Ce compte rendu a précisément pour fonction d’aider à cette indispensable transition.
Des difficultés à sortir du positivisme sans le dire en positiviste
L’introduction à l’ouvrage (pp. 9-15) est assez caractéristique des difficultés éprouvées par les auteurs à appréhender les problèmes qui y sont traités. Assez curieusement pour un ouvrage qui essaie apparemment d’évoluer par rappport à une longue tradition que l’on pourrait appeler globalement « positive » au sens large, elle exprime cette rupture de manière assez positive. On y trouve ainsi l’« objet » de recherche au centre des débats (ce qui implique la rupture entre le chercheur et son « objet », donc la désimplication), ainsi que l’idée que les connaissances se cumulent (p. 9 – ce qui signifierait qu’elles seraient homogènes, acontextuelles, anhistoriques, et pourraient s’entasser comme des lingots dans une banque, là encore, détachées de leurs producteurs), la consécration sans plus de critique du partage entre recherches fondamentales et appliquées (p. 9). Un peu timidement sans doute, mais en s’affirmant, on voit se construire une progression pour sortir du marasme : « Conseiller, peut-être prescrire, intervenir sur le social… » (p. 12), proposition qui demeure néanmoins prudente : plus les termes dénotent l’action directe, plus ils sont modalisés (« peut-être »), puisque le chercheur positiviste est censé capable de « description » pure, sans intervenir sur son « objet », cela risquerait d’adultérer la pureté de sa description, donc sa scientificité (selon les critères positivistes).
Mais ce serait faire un bien mauvais procès aux auteures de cette introduction, et cela nous rappelle sans doute que les révolutions se font dans la langue du dominant si on veut l’interpeller efficacement, car, si elles ont l’air de dire les choses dans une phraséoloie positive, elles analysent un certain nombre de problèmes avec beaucoup de lucidité et une clarté qui emportent mon adhésion pleine et entière :
« [D]es attentes contradictoires se font jour. Il s’agit d’une part de satisfaire aux attentes académiques ressenties par beaucoup comme “scientifiques” et ne se situant pas sur le terrain de l’implication. […] Enfin, les propos de jeunes chercheurs se font l’écho d’une inquiétude à coller aux exigences extra-académiques d’employeurs éventuels […] au risque cependant de tomber dans un applicationnisme non réfléchi. » (p. 12).
Si ce n’est que je pense que craindre « l’applicationisme » manifeste une difficulté à dire les choses autrement que de manière positive, puisque « applicationisme » reconduit implicitement, et sans critique aucune, le yalta épistémologique qui consacre, à la fois, la séparation du « fondamentalisme » et de l’« applicationisme », et, généralement, la suprématie du premier sur le second, ce qui est accepter des règles du jeu qui font que la partie est perdue dès qu’on a mis le pied sur le terrain (ce qui serait dommage !). De mon point de vue, ce sont justement ces règles qu’il convient d’examiner : si on ne les change pas, rien ne pourra changer, et c’est sur ce point que je diffère des contributeurs à cet ouvrage : ils pensent que des changements marginaux suffiront à amorcer le changement, je pense que le changement a tant été retardé qu’il faut maintenant un changement radical, qui critique les fondements mêmes de notre activité.
Si les réponses apportées peuvent laisser le lecteur sur sa faim, au moins les questions sont bien clairement posées dans ce paragraphe et ailleurs dans cette introduction par les éditrices de cet ouvrage régénérant à bien des égards : des jeunes chercheurs sont inquiets de l’avenir de leur discipline, s’angoissent du divorce entre l’académisme prédominant et les impératifs de la recherche d’emploi hors université et dans les organismes de recherche, et ne savent plus très bien comment équilibrer ces impératifs contradictoires. Pour cela aussi, les contributeurs à cet ouvrage doivent être remerciés : peu importe la langue dans laquelle cela se dit, positiviste ou non, le diagnostic est posé, et on ne pourra désormais plus faire comme si cela n’avait pas été dit sans prendre ses responsabilités. La façon de poser la question dans cet ouvrage m’enthousiasme, la façon d’y répondre me déçoit.
Une structure révélatrice
Voici le plan de cet ouvrage, qui regroupe les travaux présentés en quatre parties :
Applications et implications en sociolinguistique
Applications et implications en acquisition et didactique
Applications et implications en analyse du discours
Applications et implications en terminologie et lexicographie
Un bref commentaire s’impose à propos de cette structuration, d’inspiration encore très « positive » également : les spécialités des SDL sont bien ordonnées, bien étanches, à l’image de la répartition des disciplines elles-mêmes telles qu’inventées il y a un siècle(7), organisées autour d’objets qui les polariseraient et en fonderaient la spécificité, alors qu’il aurait été possible d’organiser les articles en fonction des problématiques très clairement énoncés par les éditrices à la page 12 : « la question de la posture du chercheur », « les changements induits ou produits par le travail de recherche », « l’appropriation des résultats de la recherche par les locuteurs, acteurs du terrain ou les éventuels commanditaires ». Ainsi par exemple, il aurait été possible d’organiser les articles selon les types et les degrés d’implication, et indépendamment des « spécialités », secondaires dans cette affaire. Ce plan, en faisant primer les intérêts spécialitaires, manifeste une réticence à concevoir la linguistique autrement que compartimentée en spécialités, et conforte donc l’idéologie scientifique sous-jacente : on pourrait, en restant dans un cadre traditionnel, faire évoluer la linguistique.
Mais qu’importe, peut-être ceux qui pensent cela ont-ils raison ? Il serait intéressant, au passage, de reconstituer la longue liste des domaines absents de l’ouvrage, par rapport à ces quatre secteurs d’activité, si elle ne risquait d’être bien longue. Cela suggère une orientation de réflexion : les domaines d’activité des linguistes où, apparemment ces questions ne se poseraient pas ? Ce n’est évidemment pas que ces activités n’ont aucune implication, bien au contraire. La « description » des langues, pour le dire dans les termes habituels, a bien évidemment largement contribué à la construction des nations européennes (Auroux, 1994 ; Baggioni, 1986, 1997 ; Lodge, 1997 ; Cerquiglini, 2007). Mais une partie de l’efficacité même du processus scientifico-politique engagé dépend de la capacité à convaincre les locuteurs que les langues nationales construites par la linguistique « nationiste » n’ont pas été construites par les grammairiens et linguistes, mais simplement révélées. Elles se seraient imposées « naturellement » en raison de leur supériorité « naturelle », ce qui naturalise aussi du même coup la disparition ou l’affaiblissement des langues qui n’ont pas eu la chance d’être « naturellement » parmi les plus aptes, pour reprendre la formule darwinienne (« survival of the fittest »), ce qui leur donne encore plus d’efficacité dans la contrainte, en allant d’ailleurs jusqu’à nous faire oublier que d’autres façons de concevoir les langues ont existé avant, et continuent à exister : des langues non homogénéisées, non stabilisées par exemple, qui se mélangent facilement, qui se pratiquent par fragments, de manière circonstancielle, etc. Cette direction de recherche pourrait constituer un thème à développer lors d’une future journée « Jeunes chercheurs », où l’on s’attacherait à montrer comment non seulement les chercheurs, individuellement, peuvent se trouver impliqués, mais comment l’ensemble de la discipline, institutionnellement peut se trouver « impliquée » (et d’autant plus institutionnellement que l’Etat financeur est aussi celui qui pose les objectifs). Cela passe inaperçu tant que personne ne ressent le besoin de l’expliciter, tant des imaginaires savants peuvent parfois coïncider avec les imaginaires sociaux et politiques lorsque la science assume des fonctions politiques sans attitude critique : l’égalité se mue en effet insensiblement en homogénéité, y compris linguistique et culturelle. Dans ce cas, on ne s’en aperçoit clairement que lorsque l’inertie des imaginaires savants laisse des béances par rapport aux imaginaires sociaux qui, eux, ont évolué. La mondialisation, avec ses improbables rencontres de langues, fait apparaître plus clairement, quoiqu’indirectement, les présupposés de la linguistique structuro-nationiste, et son inadéquation partielle à cette nouvelle donne.
Largués sans parachute ?
Car il est frappant de constater combien est prégnant le thème de l’implication « personnelle », « individuelle » du chercheur dans cet ouvrage, même si j’ai le sentiment que ce thème est sans doute plus clairement thématisé dans les parties qui se trouvent au début de l’ouvrage que vers la fin, ce qui aurait une certaine logique : sociolinguistes et didactologues sont peut-être plus accoutumés à s’interroger sur leur implication personnelle dans leur activité en raison du contact avec des personnes sur leur terrain, alors que d’autres spécialités, ont d’autant moins le sentiment d’implication qu’elles pensent travailler sur « de la langue » « objet », sur un code rendu inerte (ce que j’ai appelé (Robillard, 2003) la linguistification), car faiblement contextualisé et historicisé et « aseptisé » de tout investissement humain.
L’expression de ce sentiment, fréquente dans l’ouvrage, pourrait tenir à l’émiettement de la discipline en micro-spécialités enfermées de manière de plus en plus étanche sur elles-mêmes. Cela ne facilite pas les échanges, et laisse l’impression à chaque chercheur qu’il est le seul à penser comme il le fait. Bien au contraire, des journées de rencontre telles que celles dont il est fait état ici, en décloisonnant les spécialités, font apparaître de nouvelles lignes de force au sein de la linguistique, comme le souci de fonctionnalité sociale par exemple, qui, peut-être plus que les clivages spécialitaires, organise désormais les sciences du langage (du moins, c’est ce que je souhaiterais), et c’est un mérite de cet ouvrage de le faire apparaître.
Cette impression d’isolement pourrait également tenir au sentiment, éprouvé par les chercheurs, d’être « largués » par « leur » « discipline » face aux défis de l’époque actuelle, la discipline ne suscitant pas en son sein de réflexion qui puisse les aider à explorer les terrains sur lesquels ils se trouvent, à la fois sans doute mus par une curiosité de bon aloi, mais aussi taraudés par la nécessité de trouver des débouchés professionnels à l’issue de thèses longues, souvent auto-financées.
« Les enseignements du laboratoire et le mode opératoire n’aideraient en rien la réalisation de l’étude, l’agence [de création] ayant des attentes très différentes de ce à quoi nous préparait le laboratoire. […] Notons que cette distinction entre le laboratoire et l’agence de création ne cessera de s’accentuer durant la réalisation de l’étude. […] Un manque de communication […] une relative inadéquation des enseignements […] sont très certainement les explications d’un désengagement progressif du laboratoire, alors qu’au même moment l’implication de l’agence ne cessait de croître. » (Emmanuel Nicolas, p. 197).
Le fait de concevoir ces questions en termes d’ « applications » et d’« implications », en considérant que la charge de l’application repose sur le chercheur individuel seul a des effets importants (Latour, 1996). En effet, cela a pour conséquence que les orientations épistémologiques et institutionnelles de la discipline peuvent être conservées. Mais cela a un prix, lourd, inégalement et inéquitablement réparti : la charge de la résolution des contradictions de ces problèmes est en effet alors laissée au chercheur individuel, le plus souvent en début de carrière, donc fragile (alors que le chercheur confirmé pourrait se colleter à ces problèmes dans des conditions plus confortables). Une stratégie pour contourner cette difficulté consiste donc à se revendiquer d’un illustre précédent. C’est ainsi que W. Labov se voit invoqué, avec son fameux « paradoxe de l’observateur », qu’il laisse irrésolu. S’il demeure irrésolu, c’est que W. Labov lui-même (mais il y a quarante ans) ne dégage pas les conséquences ultimes de son constat. En effet, si on ne peut pas observer des êtres humains sans risquer d’influencer leur façon de se comporter en l’absence d’observateur, et si cela fait quarante ans qu’on le répète sans trouver de solution, c’est peut-être qu’il faut renoncer à cette problématique, manifestement sans issue parce qu’elle est directement empruntée, sans réelle adaptation, aux sciences « dures », dont l’ « objet » n’est pas humain (et ici Labov inspire et intimide manifestement nombre des auteurs de ce volume : si Labov n’a pas résolu cette question, moi, alors…). Dans le même esprit, C. Blanche-Benvéniste est citée, lorsqu’elle rappelle que « [ce] que nous entendons est un compromis entre ce que nous fournit la perception elle-même et ce que nous reconstruisons par l’interprétation ». On perçoit bien le problème épistémologique sous-jacent : cette citation semble faire dire à C. Blanche-Benvéniste que nos sens nous donneraient accès à des « données » incontestables, parce que libres d’interprétation, et qui seraient adultérées par les interprétations ultérieures du chercheur (alors qu’on peut argumenter que s’il ne les interprète pas, elles ne produiront jamais spontanément de sens). On peut évidemment argumenter en faveur d’une autre vision des choses (qui a l’avantage ou l’inconvénient de saper sérieusement le « corpus », emblème et pilier de la linguistique structuro-nationiste) : il n’existe sans doute pas, pour un être humain, de perception dissociable d’une interprétation, si bien qu’il serait alors vain de tenter de séparer la « donnée pure » de son « interprétation (adultérée ?) », le « corpus » de son « producteur », le « réel» de son « observateur ». Evidemment, tout comme on voit bien, au plan institutionnel et historique, pourquoi la linguistique s’est arrimée au corpus (il lui permet de naturaliser ses avis sur le monde des langues, langages, discours, et de s’arroger une position de pouvoir), on comprend, a contrario, le désarroi d’un jeune chercheur devant de telles interrogations lorsqu’il est laissé seul face à elles, puisque sa discipline ne lui permet pas de travailler légitimement ces questions, en considérant, de manière majoritaire, ces questions comme non pertinentes (et on comprend bien pourquoi) voire régressives (ces interrogations auraient trouvé des solutions depuis longtemps). Et en ne l’y formant que rarement.
Eviter les questions épistémologiques ?
L’aspect qui me semble le plus préoccupant dans cet ouvrage est en effet l’hypothèse que l’on peut y percevoir implicitement, selon laquelle on pourrait aborder la question des « applications » et des « implications » en sciences du langage sans en interroger de manière critique et fondamentale les problématiques épistémologiques sous-jacentes.
Dès le titre d’ailleurs, cela est esquissé par le pluriel de « implications » et de « applications » : il s’agit probablement moins de posture (ce qui s’exprimerait par le singulier) que de recensements de « points chauds » où sciences, implications et applications se rencontrent, même si le texte introductif a une ambition plus vaste, peut-être un peu incantatoire, puisqu’on qu’on ne la voit pas vraiment se concrétiser, par la suite, dans le recueil. A défaut d’être efficaces, les incantations ont cependant le mérite d’exprimer des désirs.
Ces questions sont travaillées de manières diverses, parfois assez contradictoires, ce qui est caractéristique du désarroi actuel de nombre de chercheurs, pris dans une période de changement auquel ne les a pas préparés leur formation, qui a marginalisé épistémologie et histoire critique de la discipline. Ces perspectives, en montrant, par le passé, comment se sont constituées des problématiques scientifiques, sont en effet les seules à nous préparer à en inventer de nouvelles, pour l’avenir, notamment en nous émancipant en montrant combien les perspectives ont varié dans le passé (et continueront donc probablement à le faire, ce qu’on ne voit pas si on pense que la linguistique commence en 1916). Au passage, on comprend les enjeux considérables qui résident dans la façon de raconter l’histoire de la discipline, puisqu’on y préfigure les évolutions futures.
On peut ainsi, à plusieurs reprises, noter que les chercheurs « disent » leur approche d’une manière qui a l’air contradictoire non pas nécessairement parce qu’elle le serait, mais probablement parce que la façon considérée comme légitime de le « dire », de le présenter, les conduit à avoir l’air de se contredire, parce qu’il est difficile de dire autrement ce qu’on a fait, parce qu’on craint que ce ne soit pas perçu comme légitime, si on le disait autrement. Cette posture est intéressante, par ce qu’elle dit du rapport à l’autorité : il est plus sécurisant de dire inadéquatement les choses comme on s’attend à ce qu’elles soient dites, même si elles sont peu cohérentes avec le fond de ce qu’on dit, que de les dire « autrement ».
Ainsi par exemple, tout en déclarant vouloir approcher un terrain sans présupposés (ce qui semble déjà bien difficile, sauf à un nouveau né), peut-on dire que l’on procède en s’intégrant à la communauté que l’on veut étudier, en allant jusqu’à entretenir des relations d’amitié avec les « locuteurs » concernés ? Il est probable que, en faisant cela, l’on complexifie ses présupposés initiaux avec d’autres, sans obligatoirement abandonner ses positions de départ d’ailleurs. C’est évidemment la façon de présenter ce processus qui est problématique, pas le processus lui-même, qui est fréquemment pratiqué. En effet, cette trajectoire peut être intéressante, à condition peut-être que ce que l’on thématise concerne le processus consistant pour un originaire de la culture x (contextualisée, historicisée) à se familiariser avec la culture y (contextualisée, historicisée) ? Ainsi, on parcourt les présupposés que l’on avait (qui renseignent sur la vision de sa communauté d’origine sur la communauté sur laquelle on veut tenir un discours), puis ceux que l’on impute au groupe auquel on s’est familiarisé (sans pouvoir être sûr que cela les caractérise dans toutes les circonstances), en terminant sur la synthèse, probablement en tension irrésolue, à laquelle on aboutit.
Peut-on également rechercher l’adéquation entre une méthodologie et un « objet » d’étude en adaptant celle-là à celui-ci ? Si l’on revient à des bases épistémologiques un peu strictes pour se donner des repères, le principe sous-jacent à une méthodologie est d’inspiration positive : c’est l’instrument qui garantirait la fiabilité des résultats, puisque ces approches se méfient de l’homme comme investigateur, en raison de l’historicisation, de la contextualisation de ses comportements, y compris comme chercheur. Cet instrument méthodologique, logiquement, ne peut pas, et même ne doit surtout pas s’adapter, pour deux raisons au moins. La première est que l’on ne peut pas adapter, par anticipation, une méthodologie à un objet que la méthodologie a en théorie pour objectif de permettre de connaître, et que l’on ne peut connaître qu’en mettant en œuvre la méthodologie. La seconde est que dans les approches classiques, puisque la méthodologie est garante des résultats, elle se doit d’être stable, uniforme, afin que la généralisation des comparaisons soit logiquement faisable. Dès qu’elle est instable, elle perd tout intérêt, en interdisant toute généralisation. Il faudrait, bien au contraire, pour être logique, expliciter le point de vue que l’on avait avant le début de la recherche (mais n’était-elle pas déjà entamée, puisqu’on avait déjà une idée sur l’« objet » ?), donc expliciter son expérience historicisée et contextualisée, qui fait, à l’évidence partie de la recherche, au moins dans ses stades initiaux, avant que l’expérience due à la recherche ne vienne la complexifier. Mais, évidemment, si l’on se réfère implicitement à des approches d’inspiration positive, on comprend bien que se dire chercheur pleinement « humain », c’est risquer de se décrédibiliser d’emblée aux yeux de positivistes. On en arrive donc, à force de vouloir parler la langue traditionnelle tout en faisant des choses qui s’y disent malaisément, par finir par avoir l’air de se contredire, parce que l’on n’a pas voulu, sinon dire contre, du moins, dire « autre », innover.
Dans ces deux cas, je pense qu’il y a toutes les chances pour que ces chercheurs aient agi de manière pertinente et intéressante pour le discours sur l’autre qu’ils veulent constituer en fin de parcours. Cependant, la façon d’expliciter leur parcours les conduit à avoir l’air de se contredire, parce qu’ils semblent tenir à se placer dans une épistémologie d’inspiration expérimentaliste, alors que ce type d’approche me semble incohérent en sciences humaines, sauf lorsqu’on a des objectifs de contrôle, de prescription de comportements (exemple : constituer une norme linguistique, ce qui a été fondateur de la linguistique). En effet, si ces approches sont cohérentes dans les sciences « dures », ce n’est pas parce qu’il s’agit d’objets naturels, mais parce que les retombées pratiques attendues sont de l’ordre de la technologie opérant en conditions contrôlées. Tant qu’on peut reproduire, dans les « applications » technologiques les conditions contrôlées de la recherche expérimentale, cela reste cohérent. Dès que l’on n’est pas certain de pouvoir contrôler les retombées pratiques comme on l’a fait des conditions d’expérimentation, la question de la pertinence des approches « technolinguistiques » (Robillard, 2007, 2008) se pose. Par conséquent, et par exemple, si on envisage la construction de tests, la mise au point de ces tests en conditions contrôlées est pertinente, si les tests seront administrés dans des conditions contrôlées de manière identique. Mais si l’on envisage simplement de « décrire » des comportements, en conditions « naturelles », la réponse est plus complexe. La linguistique a donc eu raison de s’envisager « positive » tant qu’il s’agissait de construire des langues « standard » à utiliser dans des conditions contrôlées (registres formels, très codifiés socialement, apprentissages scolaires dans des approches assez autoritaires, etc., terminologies professionnelles). Lorsqu’elle prétend faire de même pour « décrire » des comportements de la vie quotidienne sans les contrôler, la pertinence en est plus discutable, et c’est souvent le cas ici.
Il est très intéressant, à cet égard, de comparer les chercheurs de la partie « sociolinguistique », à ceux de la partie « didactique ». Les sociolinguistes courent bien plus de risques de contradiction, précisément parce qu’ils se donnent pour objectif la « description » ce qui les conduit à s’interroger sans fin sur l’ « authenticité » de ce qu’ils disent recueillir, sans pouvoir d’ailleurs donner de réponse claire (et heureusement). Plus cette « authenticité » est en apesanteur historique et contextuelle, moins elle a de sens, et plus elle risque de glisser vers l’essentialisme : on peut argumenter que tout ou à peu près peut se dire, pourvu qu’on puisse trouver le contexte adéquat. Les didacticiens tendent à accepter qu’ils doivent partir de leur rôle d’enseignant. Celui-ci referme déjà l’éventail des possibles, du fait d’un rôle professionnel qui est, par exemple, de prescrire des usages linguistiques, en usant de leur légitimité de « locuteurs natifs », et de leurs compétences professionnelles d’enseignants, ce qui fait qu’il est envisageable d’assumer, voire de revendiquer ce rôle. Mais cela n’empêche pas toujours de vieux démons de montrer le bout de leurs cornes : revendiquer une posture d’enseignant impliqué n’est pas revendiquer qu’en tant que chercheur également on est impliqué (les instances de légitimation de l’activité enseignante et de recherche ne sont pas forcément d’accord sur ce point). C’est ainsi que l’on peut être amené à indiquer, dans le même article, que les conditions expérimentales sont impossibles à respecter parce que l’on a affaire à des êtres humains (encore faudrait-il préciser à quelles caractéristiques humaines on fait allusion), tout en constatant que l’expérimentation nécessitait des groupes homogènes, ce qui est un idéal impossible à atteindre. Pourquoi alors continuer, malgré tout, à se réclamer d’une idéologie scientifique d’inspiration expérimentaliste, si elle est impraticable ? Sinon pour satisfaire à des critères académiques ? On ne peut, bien évidemment, reprocher à des jeunes chercheurs cette posture. La question s’adresse clairement à ceux qui élaborent les normes de ce qu’est le savoir scientifique, de ce qu’est une « bonne thèse », une « bonne recherche », et c’est la supplique, qui reste implicite pour des raisons faciles à comprendre, que l’on peut dégager de cet ouvrage.
Dire le changement pour faire le changement ?
Il me semble, en conclusion, que l’un des intérêts de cet ouvrage, outre la qualité des recherches qui y sont livrées, et le courage de mettre les pieds dans le plat en le revendiquant, est de susciter la réflexion sur le changement dans les sciences et dans la linguistique-sciences du langage contemporaine(s).
En effet, il me semble que, dans cet ouvrage, on perçoit bien le changement en cours, le divorce entre des façons (anciennes) de dire et des façons (nouvelles) de faire. Les façons de dire restent attachées à des formes de positivisme qui, pour avoir évolué sur des points secondaires (efforts de contextualisation notamment, mais qui laissent le chercheur hors de ce processus) restent ancrées dans l’idée que le travail scientifique a des méthodologies qui lui permettent de moins se tromper que les autres approches « profanes ». Le travail scientifique serait plus fiable parce qu’il se « confronterait » au réel, qui résisterait (de lui-même, logiquement), et le réel apprendrait donc des choses au chercheur dans cette confrontation. La réalité existerait donc bien indépendamment de tout observateur, et une indication de cela serait qu’on pourrait d’ailleurs en prélever des fragments (des corpus), les décontextualiser et les déshistoriciser sans dommage, pour les étudier, les faire parler, et nous apprendre des choses qu’on ne pourrait pas apprendre par d’autres voies.
Les façons de faire, manifestement, ont déjà changé : les pratiques racontées dans cet ouvrage sont fréquemment très clairement bien moins positivistes que les manières de le dire, et c’est une évolution à mon sens nécessaire. Mais, et peut-être est-ce particulièrement perceptible lorsqu’il s’agit de jeunes chercheurs en quête de légitimité, elles continuent d’autant plus, comme par compensation, à se dire de manière « méthodologiquement correcte ». En effet, certaines formes d’insécurité statutaires (avec des conséquences assez peu discutables), ainsi que l’inconfort d’une période de changement non maîtrisé, à l’aveugle, rendent sans doute des chercheurs débutants particulièrement sensibles aux risques de notre époque, et les inclinent sans doute d’autant plus à se mettre à l’abri derrière des figures tutélaires d’une époque en train de disparaître, ce qui fait que, l’abri se dérobant, ils se retrouvent exposés à nouveau de temps en temps. En effet, il y a probablement plus que des coïncidences purement temporelles entre la disparition des grands paradigmes de pensée politique et scientifiques (une façon de faire de la science), des grands organismes scientifiques homogènes (dans l’université française, on est professeur des universités, grand corps réputé unifié), sans même parler de la galaxie CNRS, INSERM, INRA, etc. En un sens, le désarroi lisible dans cet ouvrage est sans doute comparable à celui éprouvé par les croyants lorsque l’église catholique (étymologiquement « universelle », comme se prétendent nos sciences occidentales) s’est vue contestée par la Réforme, qui émancipait chaque fidèle, tout en le rendant désormais responsable de son interprétation de la bible. Cette responsabilité allait de pair avec une émancipation par rapport aux interprétations des hiérarques de l’Eglise (nos grands organismes, grands paradigmes épistémologiques, grands prêtres – Saussure, Chomsky, Labov, Bourdieu, Foucault…), par le passé seuls autorisés à interpréter le grand livre du monde. Ce mouvement s’est accompagné de la prolifération de confessions multiples, de visions plurielles, et d’une grande mutation technologique, celle de l’imprimerie, qui a contribué à l’essor des langues « vulgaires » (notamment, l’allemand) face au latin, parce qu’il a fallu traduire la bible dans les langues vulgaires, dans ce grand mouvement de démocratisation (en partie amorcé cependant depuis Dante). Lorsqu’on se souvient que Max Weber(8) (1904, 1905, 2004) a argumenté le rapport entre protestantisme et économie capitaliste au moment où on insiste de plus en plus sur le rapport entre technosciences et croissance économique, on s’aperçoit que le parallèle est loin d’être gratuit. Il l’est d’autant moins si l’on met cela en regard avec l’essor des communications électroniques, qui permettent à chaque « chapelle » scientifique, par le biais de revues électroniques à bas coûts, d’échapper aux contrôles sociaux des grands prêtres de la science qui, naguère, par le biais des coûts de l’impression de revues papier qui nécessitaient des financements lourds qu’ils étaient seuls à pouvoir mobiliser, rendaient malaisées des petites publications. On assiste, de ce point de vue, en ce moment, à une contre-réforme (Le Concile de Trente) qui consiste à construire un marché de la connaissance scientifique en tentant de formaliser des procédures de constitution de prix(9) (le système de classement des revues, l’élaboration des critères d’« impact factor »). Ce système désavantage clairement les petites revues électroniques dépourvues de moyens (comme le catholicisme, face à l’austérité des cérémonies protestantes, a accru le faste visuel, musical, de ses cérémonies(10), qui se voulait plus séducteur que l’austérité protestante).
On peut faire le pari que l’entreprise dont se fait l’écho écrit cet ouvrage a des chances d’être considérée comme marquante, à l’avenir parce que c’est une des premières fois dans les sciences du langage que cet inconfort face aux changements en cours se dit en se revendiquant aussi explicitement, en thématisant, par le biais du terme « jeune chercheur » les différences de classes d’âge, métonymie transparente des statuts universitaires (et question tout à fait pertinente). Tout dépendra de la réponse que nous choisirons de donner à cette question pertinente : cela peut donner lieu aussi bien à une ignorance délibérée, à la répétition des réponses adaptées pour le passé, qu’à un effort, collectif, d’élaboration d’un discours nouveau, qui me semble indispensable pour dire ce changement (mais cela implique un réel effort vers une autre culture épistémologique et historique) et donc le faire advenir.
Les pratiques à demi-explicitées par les travaux présentés dans cet ouvrage me semblent pertinentes à plus d’un titre, et les difficultés à les dire et à les revendiquer me semblent bien caractéristiques d’une période de changement, non pas qu’il s’agisse du grand soir où les paradigmes vont basculer comme dans le fantasme des Révolutions scientifiques de T. Kuhn (1972 [1959]), mais peut-être d’une aube timide où d’autres façons de concevoir la recherche commencent à se dire, encore craintivement sans doute. Un processus est peut-être mis en route dans cet ouvrage, et, si cela se poursuit, on pourra alors dire rétrospectivement qu’il aura fait date.
Cela sera en un sens faux, puisque, au moment où il est publié, personne ne ressent peut-être cela, et vrai dans la mesure où de la plupart des ouvrages qui « font date », on ne le dit que lors de relectures a posteriori. Une question, fondamentale, est posée, peut-être un peu maladroitement, par de jeunes chercheurs, mais elle en est d’autant plus poignante : oserons-nous ne pas l’entendre ?
Annexe : synthèse du point de vue de l’auteur du compte rendu
Comme je l’expose ailleurs plus longuement (Robillard, 2007, 2008), je fournis un certain nombre d’arguments pour fonder le point de vue synthétisé ci-après. Depuis que l’on pense que l’expérimentation est le moment crucial du travail scientifique, les sciences humaines se sont focalisées sur la traduction de cela dans leur domaine, à savoir le contact avec le terrain, les corpus, en oubliant que les expérimentations se font de manière acontextuelle et anhistorique, ce qui est plus difficile, sans aboutir à des incohérences (le paradoxe de l’observateur), avec des activités humaines. Comme, de plus, la spécialisation devient la règle dans le domaine scientifique, la majorité des linguistes (et peut-être des praticiens en sciences humaines) ne s’informe plus de ce qui se réfléchit dans le domaine épistémologique, dans celui, connexe, de l’histoire des sciences, et n’y forme plus ses jeunes chercheurs(11). Cela a pour effet de laisser à penser, implicitement, que les critères de scientificité élaborés au moment du développement du positivisme et de la linguistique(12), avec éventuellement quelques aménagements mineurs, suffisent à penser nos pratiques de recherche contemporaines. J’argumente ailleurs (Robillard, 2007, 2008), et avec d’autres (Blanchet / Calvet / Robillard, 2007) l’idée que cette scientificité, justement parce qu’on la croit la seule possible, doit être questionnée, car, en posant comme pilier le « recueil » de « corpus », de « traces » matérielles, elle a parfaitement convenu à l’entreprise scientifico-politique de construction des Etats-nations européens qui a été une des principales parmi celles qui ont été les siennes au moment de sa fondation. La linguistique « structuro-nationiste » a joué un rôle historique important dans la « naturalisation » des langues sous une forme qui faisait croire que les langues (et les sociétés, d’ailleurs) ne pouvaient qu’être stables, homogènes, anhistoriques, acontextuelles, ce qui permettait de rétro-légitimer les Etats-nations en construction face aux anciennes monarchies de droit divin (ce qui nécessitait de fonder les Etats nouveaux de manière aussi « solide » que les dieux, donc dans l’anhistoricité et la stabilité pourvue par le structuralisme). L’objectif implicite de naturalisation des langues, et le désir des « linguistes » de mettre en valeur leur activité ancienne (Auroux, 1994) sous les couleurs nouvelles de la « science » a modelé la linguistique et les pratiques des linguistes sur le modèle des pratiques des sciences de la nature et des scientifiques « durs », et, en dernière analyse, des religions, dans le surplomb (ce qui est l’héritage direct de Descartes, dont « la » méthode au singulier, repose sur la foi). Ces pratiques ont été critiquées à la marge de la linguistique pendant la seconde moitié du XX e siècle (sociolinguistiques, analyses du discours, ethnographies de la communication), mais le plus souvent en ne contestant pas la base même de l’épistémologie dominante qui organisait cette linguistique (un bon exemple de cela est la position d’un William Labov) et ce qui serait la fonction de base des langues et donc la préoccupation principale des linguistes, à savoir la fonction de communication au sens restreint. Il est amusant, de ce point de vue, de constater que le néologisme « Sciences du langage », forgé pour tenter construire une vision plus ouverte nécessaire au discours sur les langues (on pourrait penser que cela inclut l’histoire, la psychologie, la sociologie, l’économie…) s’interprète souvent de manière restrictive comme l’assemblage de la phonologie, de la morphologie, de la syntaxe, etc., ce qui est une façon d’organiser l’altérité et la pluralité « à la maison ».
On comprend bien que je ne peux pas m’aligner sur la position majoritairement exprimée dans l’ouvrage objet du compte rendu ci-dessus, qui consiste à rechercher quelles seraient les quelques modifications mineures qu’il faudrait apporter à la linguistique, sans toucher au fond de la question.
Bibliographie
AUROUX S., 1994, La révolution technologique de la grammaticalisation, Liège, Mardaga.
BAGGIONI D., 1986, Langue et langage dans la linguistique européenne (1876 - 1933), Lille, Atelier national de reproduction des thèses.
BAGGIONI D., 1997, Les langues en Europe, Paris, Payot.
BLANCHET Ph., CALVET L.-J., ROBILLARD D. de, 2007, Un siècle après le Cours de Saussure : la linguistique en question, Carnets d’Atelier de Sociolinguistique, n°1, http ://www.u-picardie.fr/LESCLaP/spip.php ?rubrique55
BLANCHET Ph., CALVET L.-J., ROBILLARD D. de, 2007, Un siècle après le Cours de Saussure : la linguistique en question, Carnets d’Atelier de Sociolinguistique, n°1, Paris, L’Harmattan.
CERQUIGLINI B., 2007, Une langue orpheline, Paris, Editions de Minuit.
GADET F., 2005, « Le sociolinguiste et la société civile », dans Jacquet-Pfau C., Sablayrolles J.-F. (éds.), Mais que font les linguistes ? Les sciences du langage vingt ans après, Paris, L’Harmattan, pp. 121-128.
KUHN T. S., 1972, La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion.
LEGLISE I., ROBILLARD D. de, 2003, « Applications, implications, interventions, expertises, politiques linguistiques : les (socio)linguistes entre « savants » et « mercenaires » ? », dans Billiez, J. (éd.), Contacts de langues : Modèles, typologies, interventions, pp. 237-252.
LATOUR B., 1996, Petite réflexion sur le culte moderne des dieux Faitiches, Paris, Les empêcheurs de penser en rond.
LODGE A ., 1997, Le français. Histoire d’un dialecte devenu langue, Paris, Fayard.
ROBILLARD D. de, 2003, « “What we heedlessly and somewhat rashly call ‘a language’ ” » : vers une approche fonctionnelle du (dés)ordre linguistique à partir des contacts de langues : une linguistique douce ? », dans Blanchet Ph., Robillard D. de (éds.), Epistémologie de la sociolinguistique des contacts de langues, Cahiers de sociolinguistique, n° 8, Rennes 2, pp. 207-231.
ROBILLARD D. de, 2007, « La linguistique autrement : altérité, expérienciation, réflexivité, constructivisme, multiversalité : en attendant que le Titanic ne coule pas », dans Blanchet Ph., Calvet L.-J., Robillard D. de, Un siècle après le Cours de Saussure : la linguistique en question, Carnets d’Atelier de Sociolinguistique, n° 1, http ://www.u-picardie.fr/LESCLaP/spip.php ?rubrique55, http ://www.u-picardie.fr/LESCLaP/spip.php ?article171, ou dans Blanchet Ph., Calvet L.-J., Robillard D. de, Un siècle après le Cours de Saussure : la linguistique en question, Carnets d’Atelier de Sociolinguistique, n° 1, Paris, L’Harmattan, pp. 81-228.
ROBILLARD D. de, 2008 (sous presse), Perspectives alterlinguistiques, vol. 1 : Démons, vol. 2 : Ornithorynques, Paris, L’Harmattan.
WEBER M., [1904, 1905] 2004, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Gallimard.(1) Je suis conscient de la valence inhabituelle de « argumenter ». Je souhaite ne pas utiliser le plus habituel mais belliciste « défendre » (qui « attaque » qui ?). Le terme « défendre » (en anglais, la soutenance de thèse se dit « defense ») est d’ailleurs caractéristique du paradigme popperrien-kuhnien qui est dominant, et qui fait confiance à la concurrence pour l’« avancée » autoproclamée de la science de manière, et cela a influencé jusqu’à nos pratiques discursives professionnelles. Je ne souhaite pas non plus utiliser la notion de « démonstration », qui a des connotations un peu terroristes : après la « démonstration », qui est encore en désaccord ne l’a donc pas comprise. Je pense simplement avoir des arguments à présenter, d’autres en ont d’autres, cela nous fera tous évoluer.
(2) Question accessoire : Je me suis demandé en permanence ce qu’était un « jeune chercheur » en lisant cet ouvrage, puisque la définition n’en est pas donnée, et qu’on y trouve des contributions de chercheurs chevronnés. A défaut d’un critère d’âge auquel la facilité pourrait nous incliner, il me semble qu’un critère pourrait être la posture de conformisme aux normes sans jamais les discuter (bonne nouvelle : cela risque de beaucoup nous rajeunir, puisque nous pratiquons une discipline qui répugne à se mettre en question face aux problèmes fondamentaux comme ceux de son épistémologie qui demeure, en gros positive : cela fait un siècle que nous restons jeunes !).
(3) Même si je pense que, contrairement à ce que propose implicitement le terme de « locuteur », ceux qui sont concernés par une langue peuvent ne pas la parler (Robillard, 2007).
(4) Je n’ouvre pas en détail le débat de l’épistémologie générale / régionale : s’il me semble intéressant que des spécialistes d’épistémologie tiennent des discours sur les disciplines particulières, cela n’infirme en rien la réflexion de tel ou tel spécialiste sur sa propre activité, discours qui me semble aussi pertinent, parce qu’enraciné, que le précédent.
(5) Bien entendu, on trouvera cela rarement écrit. Une pratique qui commence à être longue des commissions de recrutement universitaire, de plusieurs établissements différents me permet de formuler cela.
(6) Et non pas la « crise », que je pense salutaire.
(7) De nos jours, on peut voir les « Sciences pour l’ingénieur », les « Sciences de l’information et de la communication », qui ne se centrent pas autour d’un objet, mais d’une fonction sociale.
(8) Je remercie Jacqueline Billiez de cette idée, lors du colloque Paroles d’Outre-mer (Saint-Denis, la Réunion, 2007).
(9) Le naufrage de la revue Marges linguistiques, qui a essayé de répondre à ces exigences sans en avoir les moyens humains en est un bon exemple.
(10) Le parallèle entre religions et science n’est évidemment pas gratuit : ces deux pratiques, longtemps en concurrence (et encore, avec le débat sur l’ « intelligent design »), ont en commun de contribuer fortement à donner du sens au monde, activité éminemment éthique-politique.
(11) Combien de Masters recherche comportent-ils des enseignements d’histoire des sciences, d’histoire de la linguistique, d’épistémologie ?
(12) Saussure naît en 1857, un an avant Emile Durkheim, et l’année de la mort d’Auguste Comte.
|
Télécharger cet article : |
format.pdf (177 Ko) |
format.zip (167 Ko) |