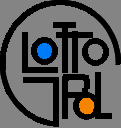
en ligne
N°20
juillet 2012
Sommaire
- Accueil
- Actualités
- Archives
- Débats
- Comptes rendus
- Appels à contributions
- Numéros précédents
- Liens
utiles
- Abonnements
ISSN : 1769-7425
|
| Téléchargement des articles |
| Résumés des articles |
Linguistiques et colonialismes. Communiquer, décrire, imposer par Cécile Van den Avenne
L’idée de ce numéro thématique partait d’une constatation : si les travaux sur la linguistique coloniale, ou sur les liens entre linguistique et colonialisme, sont bien représentés dans le domaine anglo-saxon et en langue anglaise, peu de travaux sont publiés sur cet objet en France et en français, depuis 1974, date de la première publication de l’ouvrage de Louis-Jean Calvet Linguistique et colonialisme, et les chercheurs qui s’y intéressent sont relativement isolés.
Par ailleurs, si l’on excepte le domaine spécifique de la « linguistique missionnaire » (sur lequel je vais revenir) dont les liens avec la linguistique coloniale sont importants, les travaux publiés sont essentiellement le fait d’anthropologues et non de (socio)linguistes, et l’on peut faire la remarque que, contrairement à ce qui se passe en anthropologie culturelle, l’historiographie linguistique reste encore très muette sur les liens entre science linguistique et colonialisme.
Mais tout d’abord, que faut-il entendre lorsque l’on parle de « linguistique coloniale » ? Cette appellation regroupe des textes de description linguistique produits en situation coloniale par des descripteurs européens (essentiellement, mais il peut s’agir aussi d’« indigènes » participant à l’entreprise coloniale) sur des langues extra-européennes. Ils ont pour caractéristiques communes de proposer des représentations écrites relativement unifiées de ces langues « exotiques », selon des cadres d’analyse les rendant plus familières aux Européens et de les construire en objets de savoir. C’est ainsi que Joseph Errington dans Linguistics in a Colonial World (2008) définit ce qu’est la linguistique coloniale. Et ce n’est pas sans lien avec ce que Sylvain Auroux (1992) décrit sous le terme de grammatisation, soit un processus de construction d’un savoir linguistique (par rédaction de grammaires et dictionnaires) qu’il fait remonter à la fin de l’Antiquité occidentale, et qui s’est développé à partir d’une seule tradition linguistique, la tradition gréco-latine.
Les débuts de la linguistique coloniale sont contemporains du temps des Découvertes ou des Explorations, elle est donc d’abord le fait des Espagnols et Portugais. La première grammaire du castillan, celle d’Antonia Nebrija, est publiée en 1492, et la coïncidence n’est pas anecdotique. Ceux qui partent à la « découverte » du Nouveau Monde emportent cette grammaire dans leurs bagages et elle va devenir le cadre à partir duquel la plupart des langues amérindiennes vont être décrites dès le début du XVIe siècle (la première grammaire manuscrite du nahuatl , langue du Mexique, date de 1547). L’article de Gilles Couffignal et Michel Jourde, dans ce numéro, interroge les rapports linguistiques de domination propres à cette période de grammatisation intense qu’est la Renaissance européenne. Les auteurs montrent bien les deux dynamiques, soulignées déjà par Sylvain Auroux, qui semblent déterminer la pensée linguistique de l’époque : les « découvertes » géographiques, qui augmentent considérablement le nombre de langues connues, et l’affirmation en Europe du vulgaire face au latin, qui permet l’émergence de nouvelles langues ainsi décrites et mises en valeur.
L’expansion européenne dans le Nouveau Monde, transformant la « découverte » en une entreprise de colonisation, fut accompagnée, dès ses débuts, d’une activité missionnaire de christianisation, soutenue par une activité de description linguistique et de traduction. A l’échelle mondiale, depuis le XVIe siècle et jusqu’à l’époque contemporaine (si l’on songe aux travaux de la SIL, Summer Institut of Linguistics, une organisation chrétienne qui promeut la traduction de la Bible), l’activité linguistique missionnaire est celle qui a le plus contribué à la connaissance de la diversité linguistique. Les études sur la linguistique missionnaire se sont développées autour du groupe constitué par Otto Zwartjes, qui a fondé, en 2002, le Proyecto de Lingüística Misionera de Oslo, dont le but est de promouvoir l’étude des premières descriptions modernes des langues non-indoeuropéennes réalisées durant la période coloniale espagnole et portugaise (XVIe-XIXe siècle). Différents colloques, étendant le domaine d’étude aux autres espaces coloniaux, ont été consacrés à ce domaine et ont donné lieu à la publication de plusieurs ouvrages. Si la linguistique missionnaire n’est pas à proprement parler représentée dans ce numéro, les écrits missionnaires le sont, à travers l’article de Géraldine Meret, prenant pour corpus des récits de voyage de Pères Capucins partis évangéliser les Indiens Tupis au Brésil dans les années 1613-1614, ou la contribution de Cécile Van den Avenne dont une partie du corpus consiste en grammaires rédigées par des missionnaires. J’y reviendrai en évoquant le type de sources dont dispose le chercheur s’intéressant à ces questions.
Une autre approche possible de la question, et c’est celle majoritairement privilégiée dans les travaux d’anthropologues, est d’analyser comment les technologies de l’écrit européennes ont permis la production de descriptions linguistiques qui ont fixé la représentation de langues allant de pair avec une représentation des territoires et des groupes sociaux-culturels des espaces colonisés, et comment, à partir de ces travaux descriptifs, la différence linguistique a pu devenir une ressource pour représenter et naturaliser des inégalités dans les milieux colonisés. Ces travaux s’intéressent donc aux relations entre le travail descriptif et ce que l’on nomme idéologies linguistiques. Et l’on peut citer ici les travaux de Judith Irvine sur l’Afrique de l’Ouest (2008), également l’article de J. P. Chrétien (2010) sur un dictionnaire missionnaire français-kirundi, dans le prolongement de ses travaux sur les constructions ethniques dans l’Afrique des Grands Lacs, et sur la mobilisation de la théorie dite hamitique. Dans ce numéro, la contribution d’El Hadji Abdou Aziz Faty sur les enjeux de la grammatisation du pulaar, s’inscrit dans cette démarche. Il y montre comment certains travaux d’époque coloniale (et plus particulièrement ceux de Faidherbe), par les catégorisations et délimitations qu’ils ont créées et mobilisées, ont contribué à la fixation d’une identité haalpulaar. Les travaux coloniaux de description linguistique ont pu avoir des effets sociaux durables, jusqu’à la période postcoloniale, en dessinant le contour de langues et de peuples perçus puis se percevant comme différents, en promouvant une langue véhiculaire neutre, ensuite réappropriée (c’est le cas du swahili au Congo Belge, bien décrit par ailleurs dans les travaux de Johannes Fabian), en introduisant des hiérarchies entre langues produisant des situations de diglossies durables. Dans ce numéro, l’article d’Aurélia Ferrari sur le swahili de Lubumbashi montre bien les liens entre politique linguistique coloniale et perceptions des hiérarchies linguistiques à l’époque postcoloniale.
Une autre façon de penser les liens entre linguistique et colonialisme est d’analyser le versant linguistique du processus colonial : imposition linguistique et négation linguistique (imposition de la langue du colonisateur, minorisation de la/des langues des colonisés), nomination et renomination des individus, des peuples, des lieux comme autant de pratiques d’appropriation. Il s’agit donc aussi de s’intéresser aux politiques linguistiques menés par les États coloniaux, et au delà, aux liens entre expansion impérialiste et expansion linguistique. Cette approche politique « par le haut » sous-tendait l’ouvrage de Calvet Linguistique et colonialisme (1974), observant principalement la politique linguistique de la France à l’intérieur, autour de l’idée de « colonialisme intérieur », forgée par Robert Lafont, sur laquelle revient, dans ce numéro, l’article de Christian Lagarde, et hors de ses frontières. S’inscrivant dans cette perspective, l’article d’Alice Goheneix, qui revient sur la politique linguistique menée en Afrique Occidentale Française’, s’attache à rendre compte d’une politique de « francisation restreinte » et fortement différenciée, où l’impérialisme linguistique ne va pas de pair avec une expansion de la langue du colonisateur.
De quels types de sources dispose le chercheur s’intéressant à la dimension linguistique de la colonisation ? Des ouvrages de linguistique bien sûr, des grammaires, des dictionnaires, mais également des récits de voyage, des comptes rendus de missions, des échanges épistoliers... Comme le souligne Errington, toutes les situations coloniales, quelles qu’elles soient, ont engendré des textes à dimension méta- ou épi-linguistique, qui représentent désormais une part importante des archives coloniales. Mais les textes dont l’objet n’est pas explicitement linguistique peuvent contenir des mots, des glossaires, des récits, qui sont une autre façon d’appréhender la dimension linguistique de ce que l’on appelle parfois la « rencontre coloniale » (colonial encounter). Ils peuvent nous en apprendre d’ailleurs parfois beaucoup plus que les dictionnaires et grammaires, qui gomment bien souvent les conditions matérielles de leur production, et les interactions qui ont sous-tendus leur rédaction. Johannes Fabian fut précurseur dans l’exploitation de ce genre de sources, déjà dans son ouvrage Language on the road (1984).Il y étudie l’utilisation du swahili dans deux journaux de voyage, l’un rédigé par un militaire et l’autre par des Pères Blancs, relatant tous les deux une mission depuis la côte de l’Afrique Orientale jusqu’à la région des Grands Lacs et publiés à la fin du XIXe siècle. A travers ses analyses, il tâche de répondre à ces interrogations : comment ces voyageurs pouvaient-ils communiquer avec leurs intermédiaires et les gens qu’ils rencontraient ? Comment ont-ils acquis les compétences linguistiques qu’ils disent avoir ? Et à quoi ressemblait la langue qu’ils utilisaient comme mode d’échange ? Dans ce type de travaux, il s’agit de s’intéresser aux pratiques communicationnelles à l’époque coloniale (celles des voyageurs, des militaires, des fonctionnaires, des missionnaires,... utilisant des interprètes, apprenant des rudiments de langues locales, etc.), et aux ressources linguistiques utilisées dans ces interactions. L’article de Géraldine Méret sur les processus de re-nomimation à l’œuvre dans des récits de mission de Pères Capucins, ainsi que celui de Cécile Van den Avenne sur l’usage des informateurs dans les premières descriptions de langues africaines à l’époque coloniale s’inscrivent dans cette perspective. Le premier montre comment le langage est aussi « un mode d’appropriation symbolique du monde » ; le second fait le lien avec les travaux historiographiques sur la constitution du savoir linguistique.
L’ensemble des articles de ce numéro rend ainsi compte d’approches diverses dans la façon dont on peut appréhender les liens entre linguistique et colonialisme, et de façons diverses d’analyser et mobiliser les sources, avec des variation d’échelle dans la perception des phénomènes (du micro au macro, du geste individuel à la politique étatique). L’entretien que nous a accordé Louis-Jean Calvet faisant retour sur les circonstances d’écriture, de publication ainsi que sur la réception de son ouvrage Linguistique et colonialisme nous permet aussi de revenir sur l’émergence de cet objet dans le champ de la recherche française. Du XVIe siècle au XXe siècle, les deux bornes temporelles du processus colonial européen sont tenues et les prolongements postcoloniaux contemporains sont également interrogés. Quant à la géographie qui se dessine dans ce numéro, c’est essentiellement celle d’un espace qui se construit à partir d’un regard métropolitain français. On pourrait le regretter, et l’on aurait aimé pouvoir lire aussi des contributions de chercheurs travaillant sur de tout autres espaces coloniaux. Mais d’une certaine manière, c’est assez compréhensible, les recherches des linguistes rejoignant ici celles des historiens français, avec lesquelles elles dialoguent encore trop peu (pensons par exemple aux travaux d’Emmanuelle Sibeud ou à ceux de Sophie Dulucq, ou à ceux de J. P. Chrétien déjà cités). Le travail sur les sources françaises est loin d’être épuisé au contraire, et nous espérons que ce numéro aura contribué aussi à faire du lien et à susciter d’autres travaux ainsi que des collaborations entre chercheurs.
Bibliographie
AUROUX S., 1992, Histoire des théories linguistiques, t.2, Paris, Mardaga.
CHRETIEN J. P., « Découverte d’une culture africaine et fantasmes d’un missionnaire. Le Dictionnaire français-kirundi du Père Van der Burgt (1903) entre ethnographie, exégèse biblique et orientalisme », Afriques [En ligne], n° 1/2010, mis en ligne le 21 avril 2010, URL : http://afriques.revues.org/363
DULUCQ S., ZYTNICKI C. (dir.), 2006, « Savoirs autochtones et écriture de l’histoire en situation coloniale (XIXe-XXe siècles). Informateurs indigènes, érudits et lettrés en Afrique (nord et sud du Sahara) », Outre-mers. Revue d’histoire, n° 352-353, décembre 2006.
ERRINGTON J., 2008, Linguistics in a Colonial World. A story of Language, Meaning, and Power, Blackwell Publishing.
FABIAN J., 1984, Language on the road. Notes on Swahili in two Nineteeth Century Travelogues, Hambourg, Verlag.
FABIAN J., 1986, Language and colonial power. The appropriation of Swahili in theformer Belgian Congo 1880-1938, Berkeley, University of California Press.
IRVINE J., 2008, « Subjected words : African linguistics and the colonial encounter », Language and communication, vol.28, n° 4, oct., pp. 323-343
IRVINE J., 1993, « Mastering African languages : the politics of linguistics in nineteenth-century Senegal », Soc. Anal. 33, pp. 27-46.
SIBEUD E., 2002, Une science impériale pour l’Afrique ? La construction des savoirs africanistes en France (1878-1930), Paris, Editions de l’Ehess.
ZWARTJES O., HOVDHAUGEN E. (dirs.), 2004, Missionary Linguistics / Lingüística misionera, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
Sommaire
| Cécile Van den Avenne : Linguistiques et colonialismes : communiquer, décrire, imposer. |
2 |
| Cécile Van den Avenne : Linguistique et colonialisme, 1974-2012, un entretien avec Louis-Jean Calvet. |
6 |
| Gilles Couffignal, Michel Jourde : Linguistique et colonialisme : la place des études sur le XVIe siècle européen. |
19 |
| Christian Lagarde : Le « colonialisme intérieur » : d’une manière de dire la domination à l’émergence d’une « sociolinguistique périphérique » occitane. |
38 |
| El Hadji Abdou Aziz Faty : Les enjeux du processus de grammatisation du pulaar vus à partir de la Grammaire de la langue poul (Faidherbe, 1882). |
55 |
| Aurélia Ferrari : Des archives coloniales de Lubumbashi aux pratiques et représentations linguistiques actuelles : persistance d’un « impérialisme » linguistique ? | 69 |
| Alice Goheneix : Stratification linguistique et ségrégation politique dans l’Empire français : l’exemple de L’AOF (1903-1945). |
82 |
| Géraldine Méret : Le nom propre et la propriété. Quelques problèmes posés par la nomination en situation coloniale et missionnaire : le cas des Capucins français de Maragnan. | 104 |
| Cécile Van den Avenne : « De la bouche même des indigènes ». Le statut de l’informateur dans les premières descriptions de langues africaines à l’époque coloniale. | 123 |
| Comptes rendus Céline Amourette : T. Stolz, C. Vossmann, B. Dewein (dirs.), 2011, Kolonialzeitliche Sprachforschung. Die Beschreibung africanischer und ozeanischer Sprache zur Zeit der deutschen Kolonialherrschaft [Recherches linguistiques au temps des colonies. La description des langues africaines et des langues océaniennes au temps de la domination coloniale allemande], Akademie Verlag, Brême, 312 pages, ISBN: 978-3050051901. |
142 |
Clara Mortamet : Sara Pugach, 2012, Africa in translation – A history of Colonial Linguistics in Germany and Beyond, 1814-1945, The University of Michigan Press, 291 pages, ISBN : 978-0-472-11782-6. |
145 |
Téléchargement des articles
Aide et conseils pour le téléchargement
| Linguistiques et colonialismes Téléchargement de l'ensemble du numéro |
(1114 Ko) |
(1053 Ko) |
Linguistiques et colonialismes : communiquer, décrire, imposer par Cécile Van den Avenne |
(41 Ko) |
(32 Ko) |
Linguistique et colonialisme, 1974-2012, un entretien avec Louis-Jean Calvet par Cécile Van den Avenne |
(86 Ko) |
(74 Ko) |
Linguistique et colonialisme : la place des études sur le XVIe siècle européen par Gilles Couffignal et Michel Jourde |
(116 Ko) |
(103 Ko) |
Le « colonialisme intérieur » : d’une manière de dire la domination à l’émergence d’une « sociolinguistique périphérique » occitane par Christian Lagarde |
(98 Ko) |
(86 Ko) |
Les enjeux du processus de grammatisation du pulaar vus à partir de la Grammaire de la langue poul (Faidherbe, 1882) par El Hadji Abdou Aziz Faty |
(132 Ko) |
(120 Ko) |
Des archives coloniales de Lubumbashi aux pratiques et représentations linguistiques actuelles : persistance d’un « impérialisme » linguistique ? par Aurélia Ferrari |
(199 Ko) |
(188 Ko) |
Stratification linguistique et ségrégation politique dans l’Empire français : l’exemple de L’AOF (1903-1945) par Alice Goheneix |
(125 Ko) |
(111 Ko) |
Le nom propre et la propriété. Quelques problèmes posés par la nomination en situation coloniale et missionnaire : le cas des Capucins français de Maragnan par Géraldine Méret |
(258 Ko) |
(244 Ko) |
| « De la bouche même des indigènes ». Le statut de l’informateur dans les premières descriptions de langues africaines à l’époque coloniale par Cécile Van den Avenne |
(237 Ko) |
(223 Ko) |
Compte rendu |
(39 Ko) |
(30 Ko) |
Compte rendu |
(30 Ko) |
(22 Ko) |
Résumés
| Linguistique et colonialisme : la place des études sur le XVIe siècle européen par Gilles Couffignal et Michel Jourde |
Cet article vise à interroger les rapports linguistiques de domination propres à la Renaissance européenne en liant les deux dynamiques qui semblent déterminer la pensée linguistique de l'époque : les « découvertes » géographiques, qui augmentent considérablement le nombre de langues connues, et l'affirmation en Europe du vulgaire face au latin, qui permet l'émergence de nouvelles langues ainsi décrites et mises en valeur. Au-delà d'une réévaluation de l'histoire européocentrée du savoir linguistique, les textes du XVIe siècle présentent des caractéristiques particulières dans les processus d'enregistrement de la diversité linguistique et dans les modes de défense, ou au contraire de mise à l'écart, des vulgaires, caractéristiques qui obligent à questionner aussi la notion même de « littérature ». La prise en considération des rapports linguistiques de domination au début de l’époque moderne semble rendre nécessaire une redéfinition du geste littéraire, de ce qu'est « écrire » dans « une langue ».
Mots clés : domination linguistique, colonialisation, langues régionales, grammatisation
|
Télécharger cet article : |
format .pdf (116 Ko) | format
.zip (103 Ko) |
| Le « colonialisme intérieur » : d’une manière de dire la domination à l’émergence d’une « sociolinguistique périphérique » occitane par Christian Lagarde |
En plein contexte de décolonisation, la grève des mineurs de Decazeville (1961-62) au sujet de laquelle surgit publiquement l’expression « colonialisme intérieur », déclenche une remise en cause au sein du mouvement occitaniste, surtout préoccupé de langue, de culture et de pédagogie. Le défaut de contrôle économique pèse sur un territoire et une société qui perdent leur langue (dans un processus glottophagique), leurs richesses et leurs emplois. La situation, assez similaire à celle analysée outre-mer par Fanon ou Memmi, se lit en termes d’aliénation, dont la diglossie est le symptôme. Il faut donc décoloniser l’histoire, la culture et la société. Autour de Robert Lafont qui prône la régionalisation, se fonde une sociolinguistique qui s’alimente aussi bien aux enquêtes de terrain sur l’hybride « francitan » qu’à l’analyse de la « textualisation de la diglossie » dans le discours sociopolitique (depuis la Révolution) et la fiction littéraire.
Mots clés : colonialisme – Occitanie – Decazeville – aliénation – diglossie – discours politique – analyse sociolittéraire
| Télécharger cet article : | format .pdf (98 Ko) | format
.zip (86 Ko) |
| Les enjeux du processus de grammatisation du pulaar vus à partir de la Grammaire de la langue poul (Faidherbe, 1882) par El Hadji Abdou Aziz Faty |
Au XIXe siècle, avec la naissance de l’ethnologie africaine, les Peuls et leur langue ont fait l’objet d’une objectivation et d’une mise en discours, constituant encore aujourd’hui un véritable savoir sur la langue peule (ou pulaar). La constitution de ce savoir sur la langue en question par les administrateurs coloniaux, ethnologues ou linguistes s’est fortement appuyée non seulement sur les disciplines de l’époque comme l’anthropologie physique, l’histoire de l’évolution des races, la philologie etc., mais aussi sur une littérature déjà abondante produite par des négociants, des voyageurs ou aventuriers. En partant d’un cas précis, à savoir la Grammaire sur la langue poul (1882) du Général Faidherbe, administrateur colonial, par ailleurs linguiste et ethnologue, l’article relève les idéologies linguistiques en œuvre dans le processus de « grammatisation », de description et d’explication des lois de fonctionnement de cette langue.
Mots clés : Faidherbe, linguistique coloniale, pulaar, langue peule, processus de grammatisation, catégorisation, hiérarchisation, iconization
| Télécharger cet article : | format .pdf (132 Ko) | format
.zip (120 Ko) |
| Des archives coloniales de Lubumbashi aux pratiques et représentations linguistiques actuelles : persistance d’un « impérialisme » linguistique ? par Aurélia Ferrari |
Les écrits sur le swahili au Congo Belge à l’époque coloniale sont nombreux. Ils montrent le désir des colons d’apprendre de façon simplifiée cette langue pour mieux commander, leur désir de la répandre pour favoriser la communication dans le monde du travail entre différents peuples africains et enfin de l’utiliser pour l’évangélisation. En l’absence d'un nombre important de locuteurs natifs de cette langue au Congo, le swahili s’est vite transformé au contact du français et des autres langues locales. Ce swahili fut souvent dénigré dans les écrits coloniaux, certains ont parfois tenté de l’« améliorer » pour en faire une langue nationale propre au Congo belge mais dans tous les cas il a évolué dans un complexe d’infériorité par rapport d’une part au français et d’autre part au swahili standard. Cette dévalorisation s’explique entre autre par son rapport à l’écrit presque inexistant, par son caractère récent et par sa mixité plus visible que dans les autres langues puisque plus récente. Ces représentations épi-linguistiques dépréciatives semblent avoir été transmises de générations et générations et sont encore de nos jours bien palpables à Lubumbashi. Le swahili régional est appelé « swahili facile » en comparaison au swahili bora « meilleur » de l’Est. Ce swahili qui n’a linguistiquement pas de caractère de simplification (au contraire il possède par exemple plus de classes nominales que le swahili standard et plus de conjugaisons) manque sérieusement de prestige dans l’imaginaire linguistique de la population qui pourtant le valorise dans leurs pratiques linguistiques journalières l’utilisant dans la communication courante et se l’appropriant comme langue familiale en la transmettant bien souvent à leurs enfants comme langue première. Ces représentations négatives de leur propre langue qui sont certainement le reflet d’une autodépréciation sont incontestablement une des conséquences psychologiques de la colonisation, l’infériorisation de la langue première ou maternelle entraînant un sentiment de dévalorisation de la personne.
Mots clés : représentations linguistiques – kingwana - linguistique et colonialisme – pratiques linguistiques – swahili – Lubumbashi
| Télécharger cet article : | format .pdf (199 Ko) | format
.zip (188 Ko) |
| Stratification linguistique et ségrégation politique dans l’Empire français : l’exemple de L’AOF (1903-1945) par Alice Goheneix |
En dépit de l’objectif de francisation des populations de l’empire français, affirmé publiquement dès le dernier quart du 19e siècle par l’administration coloniale, la scolarisation en français des enfants indigènes des colonies fut en réalité extrêmement restreinte, et se traduit par une pédagogie différenciée. La peur du « déclassement », c’est-à-dire de la rébellion des populations indigènes éduquées, et la volonté de transmettre à la masse une langue française rudimentaire suffisante à la transmission des ordres et au commerce permettent d’expliquer ce paradoxe apparent. Réputée intrinsèquement émancipatrice, la langue française ne pouvait être transmise « dans sa plénitude » qu’à la minorité colonisée intéressée socialement et économiquement au maintien de la domination coloniale. Alors qu’en métropole, la maîtrise de la langue française apparaît comme un signe manifeste de l’appartenance à la communauté politique, la faible diffusion de cette langue aux colonies apparaît au contraire comme le signe et le gage de l’exclusion politique.
Mots clés : déclassement, francisation, ségrégation, stratification linguistique, politique de la langue.
| Télécharger cet article : | format .pdf (125 Ko) | format
.zip (111 Ko) |
| Le nom propre et la propriété. Quelques problèmes posés par la nomination en situation coloniale et missionnaire : le cas des Capucins français de Maragnan par Géraldine Méret |
Les récits de voyage de Claude d'Abbeville et d'Yves d'Évreux, relatant la tentative française d'implantation coloniale et missionnaire au Brésil, au cours des années 1613-1614, nous permettent d'étudier la mise en place d'un rapport colonial de domination symbolique par la pratique de la dénomination. En nous intéressant plus particulièrement à l'usage colonial d'attribuer de nouveaux noms propres, nous voudrions montrer ici à partir de ces textes en quoi cette pratique constitue une violence symbolique exercée envers les Indiens, comment elle nie leur droit à disposer de leur terre et d'eux-mêmes. Mais les récits de Claude d'Abbeville et d'Yves d'Évreux montrent aussi, presque malgré eux, comment l'espace symbolique du langage peut être en retour investi par les Indiens pour subvertir le « discours du maître » inhérent à l'onomastique européenne colonisatrice.
Mots clés : noms propres, récits de voyage, colonisation, évangélisation, toponymie, anthroponymie, ethnonymie
| Télécharger cet article : | format .pdf (258 Ko) | format
.zip (244 Ko) |
« De la bouche même des indigènes ». Le statut de l’informateur dans les premières descriptions de langues africaines à l’époque coloniale par Cécile Van den Avenne |
Le propos de cet article est de rendre compte de la façon dont un certain nombre d’acteurs, qui n’étaient pas des linguistes au sens académique du terme, mais participaient de différentes façons à l’entreprise coloniale française en Afrique (militaires, missionnaires, fonctionnaires), ont recueilli des données en vue de fournir des descriptions linguistiques de langues africaines (il s’agira plus particulièrement ici d’une langue d’Afrique de l’Ouest, le bambara) et de la façon dont ils ont interagi localement avec ceux qui leur servaient d’informateurs.
L’idée est de proposer une approche de la production du savoir linguistique, ancrée dans des pratiques matérielles et interactionnelles (articulant notamment descriptions et usages), rendant compte de ce que Fabian (1986) appelle l'appropriation descriptive des langues africaines à l'époque coloniale, selon une démarche à la croisée de l'histoire, de la sociolinguistique et de l'anthropologie linguistique.
Mots clés : linguistique coloniale, missionnaire, informateurs, locuteur natif, bambara
Télécharger cet article : |
format .pdf (237 Ko) |
format
.zip (223 Ko) |
Dernière
mise à jour :
10 juillet 2012
GLOTTOPOL
GLOTTOPOL
GLOTTOPOL