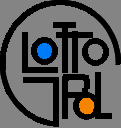
en ligne
N°26
juillet 2015
Sommaire
- Accueil
- Actualités
- Archives
- Débats
- Comptes rendus
- Appels à contributions
- Numéros précédents
- Liens
utiles
- Abonnements
ISSN : 1769-7425
|
| Téléchargement des articles |
| Résumés des articles |
Présentation par Catherine Brissaud et Clara Mortamet
Les francophones ont un rapport passionné avec leur orthographe, fait de vénération, de soumission, d’identification et de distinction. Cela fait de l’orthographe un objet de réflexion particulièrement fécond pour la sociolinguistique francophone. Nous avons choisi, pour ce numéro, de nous arrêter sur une pratique emblématique de son enseignement et de son évaluation : la dictée.
Un premier ensemble de contributions réunies ici confirme qu’elle est non seulement très pratiquée à l’école en France, mais qu’elle est plus généralement quasi-incontournable quand il s’agit d’enseigner le français écrit hors de France. Elle doit son succès aux vertus didactiques et docimologiques qu’on lui prête et qui font l’objet de la plupart des contributions de ce numéro. Mais elle sert aussi à assoir, renforcer ou réaffirmer la légitimité d’un usage, d’une tradition, d’un groupe social. C’est ce que nous révèle en particulier l’engouement pour les dictées publiques ou concours d’orthographe : elle sert alors à légitimer des usages de langues minoritaires – le breton dans ce numéro –, à certifier des éruditions ou encore, plus récemment, à valoriser des locuteurs invisibles ou minorisés – la dictée des Cités[1 ]. Ces pratiques publiques de la dictée sont peu présentes dans ce numéro. Elles constituent néanmoins un paysage dont il convient de tenir compte. Ces dictées publiques mettent en lumière le fait que la dictée est un véritable rituel, qui à la fois consacre l’orthographe du français et ses aspects les plus arbitraires, mais réunit aussi les locuteurs autour d’un « bien commun », fruit d’un héritage mythique. Au-delà de ces invariables de la dictée, l’intérêt de ce numéro est de montrer combien les pratiques de dictée, à l’école et hors de l’école, ne sont pour autant ni figées ni homogènes. Si l’on s’en tient aux pratiques scolaires, on la rencontre de plus en plus comme support d’apprentissage, comme moyen de faire parler les élèves de leurs pratiques et de leurs raisonnements orthographiques : la dictée « classique » dont parle un enseignant n’est plus aujourd'hui nécessairement la dictée magistrale. L’enseignant guide l’élève pendant la dictée, l’élève doit analyser ses erreurs, parfois défendre son raisonnement et « négocier » avec ses pairs ou avec l’enseignant les arguments pour telle ou telle graphie. Plusieurs contributions montrent ici combien les représentations que les différents participants se font de l’orthographe et de la langue déterminent cette hétérogénéité de pratiques. Là encore, la pratique de la dictée révèle sa force glottopolitique.
Un second ensemble de contributions témoigne de ce qu’on utilise la dictée aussi parce qu’elle garantit – ou semble garantir – une évaluation « objectivée » des compétences à l’écrit. Elle permet de mesurer des niveaux de compétence au sein d’une classe, d’une région, d’une population, et éventuellement de classer ou de repérer des locuteurs. Elle est donc choisie aussi comme un outil, et il convient à ce titre que l’on réfléchisse à ce que cet outil mesure ou diagnostique, aux conditions de son emploi, aux effets qu’il produit, à l’interprétation des résultats. Le point de vue de l’institution scolaire est relativement bien représenté, et l’on voit en particulier décrits les points de vue complémentaires de l’institution et des enseignants sur cet outil d’évaluation des élèves. Le rapport à l’erreur, l’interprétation de l’erreur et son analyse y sont également centraux, au point que la dictée s’avère aussi un outil qualitatif de l’analyse des pratiques et des compétences, et pas seulement un outil visant à établir des scores de performance d’un système éducatif.
Un dernier ensemble de contributions, enfin, montre comment la dictée peut servir hors de l’école, pour repérer des personnes en difficulté avec l’écrit, ou pour établir des normes statistiques, à partir desquelles on pourra repérer des populations atypiques.
Pratiques de dictées
L’article de Malo Morvan, qui inaugure ce numéro, offre grand nombre d’éléments de réflexion, d’ordre général ou particulier, qui invitent à réfléchir à la diversité des pratiques de dictée. En s’intéressant à des dictées publiques en breton – la skrivadeg, il nous permet un pas de côté particulièrement fertile. En tout premier lieu, il comble d’une certaine façon l’absence, dans ce numéro, de textes d’ordre historique sur la dictée – absence davantage due à ce qu’il n’y a sans doute plus tant à en dire depuis Chervel (2006) ou Caspard (2004). En particulier, il nous rappelle les débats, les tensions, les conflits dans lesquels se construit tout consensus autour de la fixation d’une orthographe. Il souligne combien la référence, par la dictée, à une orthographe, marque toujours une adhésion, sans cesse renouvelée, à une norme, et constitue l’un des principes unificateurs privilégiés des communautés linguistiques et nationales européennes. La dictée est un lieu de cohésion, une « communion » nous dit l’auteur. Cette idée de rassemblement repose sur un fondement qui n’est jamais remis en cause : on ne fait jamais référence qu’à une seule forme possible, à une norme unique, qui exclut toute variation – situation, nous dit l’auteur, d’autant plus paradoxale que c’est l’idéologie même qui a contribué à la perte du breton. En dehors de quelques allusions ici ou là, on retrouve cette référence à une norme unique dans la plupart des situations de dictée décrites dans ce numéro : les grilles de correction ne prévoient quasiment jamais plusieurs formes acceptables – principe sur lequel reposent pourtant les rectifications orthographiques de 1990.
Ce texte met enfin le doigt sur d’autres aspects de la dictée, qui mériteraient peut-être d’être réaffirmés pour d’autres pratiques de dictée, et en particulier pour les dictées scolaires ; en premier lieu, l’article situe la dictée publique parmi les jeux, à ce titre plus proche d’une course à pied, d’un rallye ou d’une « poule à la manille » que d’un examen : c’est une fête populaire, dont le but est d’abord de s’amuser. Cela tient bien sûr au volontariat des participants. Mais on pourrait se demander si, à l’école, elle n’est pas aussi traversée par un aspect ludique, quand les élèves sont invités à déjouer des « pièges », à « viser juste » sur tel ou tel point.
On l’aura compris, le texte de Malo Morvan, prenant pour terrain la skrivadeg, et examinant son émergence, son évolution, les discours qu’elle produit et qui sont produits à son propos permet donc d’élargir le cadre de réflexion sociolinguistique de cette pratique sociale qu’est la dictée.
Les contributions qui suivent portent sur le français, et pour l’essentiel sur des pratiques scolaires de la dictée.
Des pratiques ancrées dans la tradition
L’importance de la pratique de la dictée à l’école en francophonie a déjà été soulignée par Brissaud et Cogis (2011 : 111-121). Chervel a montré, quant à lui, que bien que pratiquée depuis plusieurs siècles, elle a beaucoup évolué (2006). L’article d’Evelyne Delabarre et de Marie-Laure Devillers réaffirme, à l’appui de données récentes, le caractère incontournable de la dictée. Mais les auteures montrent aussi que l’on est loin du modèle magistral, peut-être mythique : les enseignants ne font jamais que dicter un texte, mais dans le même temps rappellent des consignes formelles, des règles de comportement et d’interaction, voire anticipent sur les difficultés des élèves et livrent un grand nombre d’« indications », qui guident leur attention ou leur raisonnement orthographique. En comparant plusieurs situations de dictées, cet article montre aussi la très grande hétérogénéité des réalisations concrètes, et amorce l’idée, qui sera poursuivie dans l’article de Combaz et Elalouf, que cette variabilité tient pour partie aux élèves, mais tient aussi à la variabilité des rapports personnels et professionnels des enseignants à l’objet enseigné.
La contribution de Téguia Bogni et de Mohamadou Ousmanou confirme l’importance de cette activité, cette fois hors de France. La dictée est en effet très présente dans les pays francophones africains. La situation qu’ils exposent est remarquable à plusieurs titres : on y trouve l’expression la plus forte de la « dictée-contrôle », voire la « dictée-sanction » puisqu’il apparait que la dictée donne lieu à « un festival de zéros », à tel point que l’on ne peut lui trouver aucune qualité diagnostique, ni même formative. Mais le plus surprenant est l’attachement que lui portent des institutions éducatives, en cohérence avec leur revendication d’enseigner le français au Cameroun en dépit des autres langues en présence, comme une langue maternelle des apprenants et non comme une langue seconde.
Des dictées pour apprendre
À côté de ces pratiques relativement traditionnelles, ce numéro de Glottopol a été aussi l’occasion de rendre compte d’expériences, de plus en plus nombreuses, où la dictée devient un moyen de faire émerger des conceptions des élèves. Il est ainsi question, avec les trois contributions qui suivent de phrase dictée du jour et de dictée 0 faute, de dictée négociée et de négociations orthographiques entre élèves. Chaque fois, les analyses s’appuient sur des interactions en classes (entre élèves, avec l’enseignant), interrogent les pratiques d’étayage, les conceptions et les raisonnements des élèves, et dégagent quelques-unes des conditions de réussite de ces activités. Ces trois contributions participent ainsi du renouvellement actuel des pratiques d’enseignement de l’orthographe (telles que suscitées par les travaux de Haas et Lorrot, 1996). Elles sont à ce titre particulièrement intéressantes pour les enseignants, futurs enseignants et les formateurs qui nous lisent.
Danièle Cogis, Carole Fisher et Marie Nadeau, soulignant les paradoxes liés à la dictée, dont les vertus n’ont jamais été démontrées, décrivent deux dispositifs innovants : la phrase dictée du jour et la dictée zéro faute testés dans le cadre d’une recherche-action franco-québécoise. Leur hypothèse est que le temps octroyé aux élèves pour apprendre à mettre en œuvre des raisonnements grammaticaux, à mobiliser leurs connaissances, est un temps bénéfique aux apprentissages. C’est ainsi qu’elles donnent à voir des élèves en prise avec la complexité de l’orthographe du français quand ils écrivent « Tout le monde sera récompensé » ou « Les feuilles colorées des arbres composent un paysage… ». Les échanges recueillis dans la classe révèlent des « nœuds sémantiques imbriqués » que les dispositifs permettent de travailler. Plusieurs mois d’expérimentation permettent d’obtenir des procédures efficientes, par l’utilisation du métalangage et des manipulations, y compris pour les élèves faibles, dont les progrès sont considérables, autant en situation de dictée qu’en situation de production d’écrit. Pour les trois auteures, les deux dispositifs testés permettent ainsi de « combler le vide entre l’énoncé de la règle et son application ».
On insistera ici sur l’intérêt que les trois didacticiennes portent au fait de dégager les conditions de réussite de ces dispositifs innovants, parmi lesquelles des éléments également mentionnés dans d’autres articles, comme la question des compétences linguistiques et grammaticales des enseignants, l’usage des métatermes, du nom des lettres, le rapport à l’erreur, etc.
La contribution de Catherine Combaz et de Marie-Laure Elalouf vise à mesurer l’effet des représentations que les enseignants se font de l’orthographe et de son enseignement sur leur pratique en classe. Sur ce point, cet article prolonge très utilement les réflexions amorcées par Evelyne Delabarre et Marie-Laure Devillers. Les auteures montrent ainsi qu’il s’agit de l’une des variables déterminant fortement la qualité de l’étayage de l’enseignant : « Les enseignants agissent alors en fonction de plusieurs paramètres dont ils ont plus ou moins conscience : leur facilité à mobiliser des scénarios d’enseignement plus ou moins bien intériorisés, leur volonté d’être exhaustif au regard du savoir en jeu (ou du savoir à enseigner), leur souhait de répondre aux obstacles que chacun des élèves leur a donné à voir et à comprendre… ». En outre, elles soulignent un aspect déjà souligné par Danièle Cogis, Carole Fisher et Marie Nadeau : le fait que l’usage des métatermes est un élément pertinent pour décrire la diversité des pratiques, en ce qu’il facilite ou fait obstacle à l’apprentissage de l’orthographe.
Enfin on soulignera le fort ancrage de cet article dans des situations de formation des enseignants : l’objectif visé n’est pas tant ici de dégager de bonnes pratiques, que de fournir aux enseignants les conditions d’une réflexion sur leurs propres pratiques et sur leurs effets sur les apprentissage des élèves. On retrouve d’ailleurs cette préoccupation forte d’être utile et pertinent sur le terrain, de transformer les pratiques de classe dans les articles de D. Cogis, C. Fisher et M. Nadeau, de S. Anxionnaz, de S. Briquet, de J. Gonac’h, et de V. Miguel Addisu.
Véronique Miguel Addisu conduit une étude de type ethnographique qui s’attache à décrire les pratiques de dictée dans six classes de CM1. L’originalité de l’approche provient de la focalisation sur les temps de correction et leurs effets sur les élèves.
Trois types de démarche se dégagent dans les six classes, caractérisés par l’investissement limité dans la correction avec un travail plutôt individuel de correction (et un attachement de l’enseignant à la norme) ; la régulation des interactions (dans l’esprit de Haas et Lorrot, 1996) par le maitre, qui favorise les interactions collectives de type métalinguistique avec renvoi aux outils ; l’organisation des interactions entre les pairs sur fond de développement d’autonomie.
Véronique Miguel Addisu s’interroge en outre sur ce qui fait la difficulté d’un texte, sur l’appui sur le sens en cours de dictée (le sens apparait comme très peu exploité), sur le taux d’efficacité des corrections, sur le rapport entre autonomie et nombre d’erreurs, autant d’indicateurs à interroger en situation d’observation mais aussi de formation. Bien que l’étude ne concerne que six classes, on est frappé par la diversité des pratiques qui mettent en jeu ou non le groupe, proposent ou non des situations-problèmes.
La dictée comme outil de mesure
Dans les contributions suivantes, on retrouvera plus d’une des questions soulevées jusqu’ici, mais on interrogera cette fois la dictée comme pratique permettant de mesurer, d’évaluer les compétences de populations à l’écrit. Il s’agit donc d’interroger les conditions dans lesquelles on l’utilise, ce qu’elle mesure, et comment on interprète les résultats. On essaie cette fois d’objectiver, de ne pas trop dépendre des représentations des différents acteurs. On interrogera ainsi la question des textes proposés, du traitement des erreurs, des barèmes, des comparaisons de résultats.
Mesures par l’institution scolaire
L’interview par Catherine Brissaud de Bruno Trosseille, chef du bureau des écoles à la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) concerne la place de la dictée dans les évaluations conduites par la DEPP. La dictée est relativement peu utilisée par la DEPP, essentiellement pour des raisons de cout, mais aussi parce qu’elle est considérée comme un indicateur tout relatif de la compétence orthographique. Sa mise en œuvre peut viser deux objectifs très différents. Le premier objectif peut être de mesurer, à plus ou moins long terme, l’évolution dans le temps des compétences des élèves. Dans ce cas, les passations sont contrôlées et la correction est centralisée, et l’évaluation peut constituer une aide à la décision politique. Son objectif peut aussi être d’établir un bilan, une mesure diagnostique en début d’année afin d’aider les enseignants à organiser leur enseignement. Dans ce cadre, qui est celui des évaluations nationales telles que pratiquées depuis 1989, c’est l’enseignant qui fait passer les évaluations à sa classe. La prise de décision politique ne peut donc s’appuyer sur les résultats des dernières évaluations nationales, qui changent tous les ans et dont les conditions de passation ne sont pas contrôlées.
Si les deux conceptions sont assez différentes selon la DEPP, il n’est pas dit que, sur le terrain, elles soient considérées comme différentes : les dictées sont (toujours) vues comme des évaluations du niveau des élèves, de la qualité de l’enseignement, de la pertinence des programmes. Elles sont finalement peu utilisées comme diagnostic. La forme même de dictée diagnostique est-elle possible sans être pervertie par le modèle de la dictée-bilan et les enjeux politiques de ces évaluations ?
Le barème adopté, et les choix dont il peut faire l’objet, sont également abordés. Comme dans plusieurs articles, on retrouve le rapport à l’erreur (et donc aussi à ce qui est acquis), la hiérarchie des compétences orthographiques. Ici le mythe de la dictée comme outil fiable et incontestable pour évaluer un niveau d’orthographe est mis à mal. Cette contribution montre néanmoins que la dictée reste un outil pertinent, à condition que l’on s’en saisisse véritablement, pour évaluer des compétences et des difficultés, et donc pour guider les élèves et les enseignants dans l’apprentissage de l’orthographe.
Sophie Anxionnaz présente un nouveau système de notation, qui a été expérimenté pour l’évaluation de la dictée du brevet des collèges. C’est ici l’institution elle-même qui explore d’autres voies d’évaluation et qui propose un barème alternatif au barème traditionnel adopté pour la dictée du brevet. Ce système de notation nouveau, initié avec Olivier Barbarant, Inspecteur Général, met davantage en relief les réussites que le barème traditionnel, qui procède par retrait de points ; il a donc pour ambition de « changer la perception de la dictée, et, avec elle, de l’orthographe, pour réconcilier les élèves avec l’écriture ». Ici on regroupe les items par grandes catégories d’erreurs sans forcément prendre tout en compte : les accords dans le groupe nominal, les accords sujet-verbe et le lexique font l’objet d’un sous-score de réussite. Plus qu’un barème renouvelé, c’est un véritable outil de calcul qui est proposé. L’enseignant saisit le texte de la dictée, choisit les éléments qui seront évalués, les répartit dans les trois catégories. Au bout du compte c’est une évaluation de la dictée mieux intégrée à l’apprentissage qui est proposée, avec un barème raisonné.
Analyser les erreurs
Mesurer au moyen de la dictée peut aussi donner lieu à des analyses qualitatives des productions recueillies, et l’on s’interroge alors non plus tant sur les « niveaux des élèves » que sur l’hétérogénéité de leurs erreurs d’orthographe.
La contribution d’Eugenie Grace Essoh Ndobo et de Veronica Ebica Odey montre en quoi la dictée permet de révéler certaines pratiques orthographiques spécifiques à des apprenants de français en milieu plurilingue. En analysant les formes erronées proposées par des apprenants de l’université de Calabar au Nigéria, les auteures mettent au jour les effets à la fois des langues locales – ici le yoruba, l’efik et l’ibibio, langues maternelles des apprenants – mais aussi ceux, plus importants encore, de l’anglais, langue de scolarisation. Les langues premières ont en particulier des effets sur la perception des phonèmes du français, et par conséquent sur la dimension phonographique de l’écriture, quand l’anglais, langue principale de l’écrit des apprenants, agit davantage sur la dimension sémiographique et les régularités de séquences graphiques.
C’est aussi dans un rapport positif à l’erreur que se situe Jeanne Gonac’h, qui examine les erreurs, ou plutôt ce qu’elle considère comme de la variation, dans quatre textes de dictée recueillis dans quatre classes de CM1. S’appuyant sur des travaux de sociolinguistes de l’écriture (Lucci et Millet, 1994), mais aussi sur le travail fondateur d’Henri Frei dans sa Grammaire des fautes, paru en 1929, elle s’intéresse à des secteurs de l’orthographe identifiéscomme complexes, les formes verbales en /E/, les morphogrammes lexicaux et le doublement des consonnes. Les erreurs sont alors envisagées comme « révélatrices » du fonctionnement du système d’écriture, mais aussi du fonctionnement des élèves en situation d’écriture scolaire. Elles ne sont donc pas aléatoires, et traduisent aussi des formes de compétences des élèves, ainsi que les rapports qu’ils entretiennent avec l’orthographe. On y observe, en particulier, de nombreux phénomènes de simplification, de régularisation – que l’on peut expliquer avec Frei en termes d’assimilation ou d’invariabilité – et de rares situations de complexifications par rapport à la forme attendue, qui peuvent faire penser à des efforts de distinction.
Un peu en marge car il concerne la lettre et non la phrase ou le texte, l’article de Sophie Briquet-Duhazé se focalise sur la dictée de lettres au CM1. La connaissance du nom des lettres (leur nom, leur son, leur graphie) apparait en effet comme un bon « prédicteur » de la réussite future en littéracie, c’est-à-dire la capacité à utiliser ses connaissances en lecture et en écriture. Une première expérimentation, conduite avec plus de 300 élèves de CE2 montre que la connaissance du nom des lettres n’est pas parfaitement maitrisée par la moitié des élèves à ce niveau de scolarité. C’est pourquoi l’auteure propose une dictée individuelle de lettres à 30 élèves de CM1 d’une école classée en REP. Si le groupe des huit « bons lecteurs » ne fait pas d’erreur, on note des hésitations, des oublis, des erreurs (par exemple des confusions : v pour w, w pour z, q pour k) pour 19 élèves. L’auteure attire ainsi l’attention sur des « apprentissages admis » qu’elle propose de contrôler, y compris avec des élèves avancés dans leur scolarité.
La dictée hors de l’école
Les trois dernières contributions sortent du contexte scolaire, pour envisager la dictée comme une épreuve visant à mesurer les compétences en écriture d’une population. Il s’agit dans ces contributions de trouver le moyen de caractériser des populations atypiques, qu’elles soient en grande difficulté (Jean-Pierre Jeantheau ; Carole Blondel et Jeanne Conseil), ou qu’elles relèvent de l’orthophonie (Mickaël Lenfant). Dans les deux cas, cela implique de s’interroger sur l’étalon à partir duquel établir ces profils atypiques, de se demander, pour chaque population, ce qu’il est normal de savoir écrire ou non.
La contribution de Jean-Pierre Jeantheau s’appuie sur l’enquête Information et Vie quotidienne (IVQ) menée par l’INSEE en France depuis 2004. Cette enquête est d’abord décrite dans ce qu’elle a de particulier ou de commun avec les autres enquêtes de mesure des compétences de lecture-écriture-numéracie menées dans la plupart des pays occidentaux – mais aussi en Corée et en Chine. S’appuyant sur un relevé systématique des différentes expériences, internationales ou nationales, il montre l’originalité de l’approche française, l’une des seules à évaluer les compétences de mise à l’écrit des locuteurs, au moyen d’une dictée de mots. Ainsi, en dehors des initiatives, en Chine ou en Allemagne, décrites par l’auteur, les locuteurs sont évalués dans la plupart des enquêtes sur leur capacité à recevoir des informations par écrit, mais beaucoup plus rarement à en émettre.
Il s’attache ensuite à décrire les réflexions que soulève l’utilisation de ce type d’épreuve, à commencer par le choix des termes, le plus souvent conditionné par la difficulté supposée des items, et non par les difficultés rencontrées par les locuteurs, ou par ce qui fait véritablement obstacle à la communication par écrit. À l’appui des données que fournit l’enquête IVQ – données remarquables à la fois pour leur étendue (population de 16 à 65 ans, dans toute la Métropole et les DOM-TOM) et pour leur représentativité (tirage aléatoire des enquêtés au sein de la population recensée) –, il montre ce que mesure réellement la dictée ; c’est-à-dire en quoi les difficultés orthographiques repérées dans cette épreuve sont liées à d’autres compétences littéraciques – la compréhension écrite, la compréhension orale, la lecture – ou à la numéracie. S’appuyant sur une comparaison des résultats obtenus en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, il montre enfin l’importance, pour mesurer les difficultés à l’écrit, de tenir compte certes de la plus ou moins grande régularité ou prévisibilité de l’orthographe d’un mot, mais aussi des expériences qu’ont les locuteurs de l’écrit, de leurs socialisations dans des environnements graphiques et langagiers variables et socialement déterminés.
L’article de Carole Blondel et de Jeanne Conseil porte lui aussi sur les données de l’enquête IVQ, mais s’attache à décrire plus précisément les formes relevées pour orthographier 16 mots de l’enquête conduite par INSEE, au sein de deux sous-populations : celle des haut-Normands et celle des Rhônalpins en potentielle difficulté avec l’écrit. Elles mènent cette analyse à l’appui de différentes approches complémentaires. Elles commencent ainsi par relever les taux de réussite pour chacun des mots, en établissant deux « niveaux de réussite » : une réussite « orthographique » – réussite « totale » pourrait-on dire –, lorsque la forme orthographique attendue est donnée, et une réussite « phonographique » lorsque la forme produite, bien qu’erronée, correspond à une transcription phonographique possible de la forme orale dictée. Ces deux scores permettent ainsi de dégager trois profils de scripteurs, et s’avèrent particulièrement intéressants pour évaluer les compétences à l’écrit des personnes considérées au terme de l’enquête comme étant en difficulté. Dans un second temps, se concentrant sur les trois graphies qui ont posé le plus de difficulté aux scripteurs dans les deux régions, les auteures analysent la dispersion des réponses produites et dégagent les formes graphiques récurrentes dans le corpus. Elles montrent ainsi à la fois la diversité des stratégies et des procédures d’écriture à l’œuvre dans cette population, mais aussi des phonèmes et des graphèmes particulièrement sources de variation.
L’article de Mickaël Lenfant, qui clôt ce numéro, offre une dernière application possible de la dictée, telle qu’elle est pratiquée en orthophonie. Bien que très peu décrite, celle-ci partage avec le reste des contributions plusieurs pistes de réflexion. L’objectif de la dictée qu’il décrit est pourtant au départ assez particulier puisqu’il s’agit de dégager ce que serait une compétence « normale » en orthographe à un âge donné – de 8 ans (CE2) à 11 ans (CM2) : « à la différence de l’école, où les résultats sont comparés par rapport à une note maximale et à la moyenne de sa classe, en orthophonie, les résultats du patient sont comparés par rapport à la moyenne des enfants de son âge ou de son niveau scolaire ». Plutôt que de diagnostiquer des défauts pour y remédier, il s’agit de repérer les erreurs « normales », d’étalonner des pratiques, dans la perspective de repérer des pratiques a-normales, qui pourraient relever de l’orthophonie. Ainsi la notion de pathologie s’appuie-t-elle sur l’idée d’un seuil, est établie comme un écart statistiquement peu probable à la norme. Le projet rejoint ainsi le vœu de Jean-Pierre Jeantheau, qui souligne l’écueil méthodologique qu’il y a à comparer les pratiques des personnes en difficulté avec la norme théorique et non avec la norme statistique, c’est-à-dire avec le dictionnaire plutôt qu’avec l’usage. Mais l’idée de norme ou de normalité risque, si l’on en reste là, de se limiter au seul critère de fréquence : ce qui est normal est ce qui est courant. C’est pourquoi Mickaël Lenfant complète cette approche par une analyse qualitative des productions des enfants, qui s’avère indispensable pour éclairer l’approche statistique et repérer les pathologies.
Plus généralement, on trouvera dans la contribution de Mickaël Lenfant une présentation de l’épreuve de dictée telle qu’elle est pratiquée en orthophonie. Plus encore que dans les enquêtes quantitatives déjà présentées, les compétences visées sont objectivées (ce sont d’ailleurs des « cibles » pour les concepteurs du test), et l’évaluation s’appuie sur des outils de mesure statistiques et systématiques. En plus des analyses quantitatives de performance générale au sein d’une population, cela permet une comparaison des réponses en fonction des niveaux scolaires, du genre, des catégories socio-professionnelles des parents, ce que l’auteur ne manque pas de présenter pour alimenter les réflexions quant à la détermination sociale des compétences orthographiques des élèves.
À la lecture de ces contributions, il apparait que le succès de la dictée repose sur différents aspects. La dictée est d’abord une tradition, qui réunit les locuteurs avec leur passé – scolaire en particulier– et avec leur communauté linguistique. Elle s’avère d’une grande puissance identitaire, ce qui explique les réactions et les résistances fortes qu’elle soulève lorsqu’il s’agit d’en modifier son barème ou ses fonctions. Cela explique également l’importance des représentations et des pratiques qu’elle génère, etc. Mais son maintien est renforcé, plus récemment, par une tendance forte, dans les sociétés occidentales, aux évaluations quantitatives nationales et internationales.
Il apparait également, en observant les situations scolaires et extra-scolaires, que les dictées n’évaluent jamais toute l’orthographe – et encoremoins toute la langue–, mais seulement des points d’orthographe ciblés, précis. Ils n’en sont pas moins interprétés comme des symptômes (si les élèves les réussissent, c’est qu’ils connaissent le reste, ou à l’inverse ; s’ils échouent ici, c’est donc qu’ils échoueraient ailleurs). Cela conduit à s’interroger sur la « solidarité » des différentes compétences orthographiques les unes avec les autres.
Au-delà de la diversité des situations qui sont présentées dans ce numéro, la dictée est toujours abordée comme une pratique sociale, mettant en lumière les fonctions qui lui sont données, que ce soit en termes didactiques et/ou sociolinguistiques. Chaque fois, il apparait que les pratiques sont fortement déterminées par les représentations que se font participants et observateurs – c’est-à-dire les concepteurs, les scripteurs, les analystes des résultats, … – de l’orthographe, et de sa capacité à intégrer les locuteurs dans la communauté de la langue – française ou bretonne.
Enfin, bien que ce ne soit jamais exprimé en ces termes, il apparait à la lecture de ce numéro que, tout autant que les pratiques, la dictée évalue ou implique l’adhésion des scripteurs à une échelle de valeur dans laquelle l’écrit, dans sa dimension la plus réglée et autoritaire (l’orthographe), occupe une position haute parmi les usages du français. Si la dictée comme outil d’apprentissage fait son chemin, le peu de tolérance face à l’écart ou à l’erreur confirme que la route est encore longue avant une simplification, pourtant souhaitée par de nombreux linguistes, de l’orthographe du français.
[1 ] Dictée publique organisée dans plusieurs « quartiers de France et au-delà de nos frontières » par l’écrivain Rachid Santaki et le président de l’association Force des Mixités Abdellah Boudour. Plus d’informations sur : http://ladicteedescites.com/. Lire aussi l’article de Rachid Santaki, « Quand la dictée réunit toutes les France » (juin 2015) : http://www.huffingtonpost.fr/rachid-santaki/dictee-des-cites-saint-denis_b_7419296.html.
Bibliographie
BRISSAUD Catherine, COGIS Danièle, 2011, Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui ?, Hatier, Paris.
CASPARD Pierre, 2004, « L’orthographe et la dictée : problèmes de périodisation d’un apprentissage (XVIIe-XIXe siècles) » dans Le cartable de Clio. Revue romande et tessinoise sur les didactiques de l’histoire n°4, pp. 255-264.
CHERVEL André, 2006, Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Retz, Paris.
FREI Henri, 1929 [1971], La grammaire des fautes, Slatkins, Genève.
HAAS Ghislaine, LORROT Danièle, 1996, « De La grammaire à la linguistique par une pratique réflexive de l’orthographe », dans Repères n° 14, pp. 161-181.
LUCCI Vincent, MILLET Agnès, 1994, L’orthographe de tous les jours, enquête sur les pratiques orthographiques des Français, Honoré Champion, Paris.
Sommaire
| Clara Mortamet et Catherine Brissaud : Présentation |
2 |
Malo Morvan : La skrivadeg, une communion en paradoxes |
11 |
Evelyne Delabarre et Marie-Laure Devillers : Mise(s) en œuvre d’une activité orthographique : la dictée. |
48 |
Téguia Bogni et Mohamadou Ousmanou : Pratiques de la dictée en classe de français dans l’enseignement secondaire au Cameroun. Analyse des approches et de la performance d’élèves dans un lycée à Ngaoundéré. |
58 |
Danièle Cogis, Carole Fisher et Marie Nadeau : Quand la dictée devient un dispositif d’apprentissage. |
69 |
Catherine Combaz et Marie-Laure Elalouf : Une phrase dictée, trois enseignants, trois formes d’étayage. |
92 |
Véronique Miguel Addisu : Conscience métalinguistique et norme orthographique : qu’apprend-on en corrigeant sa dictée ? |
111 |
Bruno Trosseille par Catherine Brissaud : Entretien : La place de la dictée dans les évaluations conduites par la DEPP |
127 |
Sophie Anxionnaz : Le barème graduel : l’évaluation de la dictée au service des apprentissages. |
135 |
Eugenie Grace Essoh Ndobo et Veronica Ebica Odey : Difficultés et erreurs dans le passage de la phonie à la graphie en dictée de langue française : cas des apprenants du FLE de l’université de Calabar (Nigéria). |
157 |
| Jeanne Gonac'h : Des variations orthographiques dans les dictées de CM1. |
167 |
| Sophie Briquet-Duhazé : La dictée de lettres : qu’en est-il au CM1 ? |
178 |
| Jean-Pierre Jeantheau : La dictée dans les enquêtes sur la « littéracie » des adultes : pratiques, résultats, exemples d’analyses, perspectives. |
190 |
Carole Blondel et Jeanne Conseil : La dictée dans l’enquête IVQ : variation et compétences d’écriture des scripteurs en difficulté avec l’écrit dans les régions Haute-Normandie et Rhône-Alpes. |
207 |
| Mickaël Lenfant : La dictée dans un bilan orthophonique : analyse psycho-sociolinguistique des données de l’étalonnage du texte à trous d’Exalang 8-11 ans. | 226 |
Téléchargement des articles
Aide et conseils pour le téléchargement
| La dictée : une pratique sociale emblématique Téléchargement de l'ensemble du numéro |
(2567 Ko) |
(2385 Ko) |
Présentation par Clara Mortamet et Catherine Brissaud |
(56 Ko) |
(46 Ko) |
La skrivadeg, une communion en paradoxes par Malo Morvan + erratum (décembre 2017) |
(207 Ko) |
(187 Ko) |
Mise(s) en œuvre d’une activité orthographique : la dictée par Evelyne Delabarre et Marie-Laure Devillers |
(65 Ko) |
(55 Ko) |
Pratiques de la dictée en classe de français dans l’enseignement secondaire au Cameroun. Analyse des approches et de la performance d’élèves dans un lycée à Ngaoundéré par Téguia Bogni et Mohamadou Ousmanou |
(559 Ko) |
(547 Ko) |
Quand la dictée devient un dispositif d’apprentissage par Danièle Cogis, Carole Fisher et Marie Nadeau |
(169 Ko) |
(150 Ko) |
Une phrase dictée, trois enseignants, trois formes d’étayage par Catherine Combaz et Marie-Laure Elalouf |
(199 Ko) |
(183 Ko) |
Conscience métalinguistique et norme orthographique : qu’apprend-on en corrigeant sa dictée ? par Véronique Miguel Addisu |
(212 Ko) |
(196 Ko) |
Entretien : La place de la dictée dans les évaluations conduites par la DEPP de Bruno Trosseille par Catherine Brissaud |
(56 Ko) |
(45 Ko) |
Le barème graduel : l’évaluation de la dictée au service des apprentissages par Sophie Anxionnaz |
(245 Ko) |
(224 Ko) |
Difficultés et erreurs dans le passage de la phonie à la graphie en dictée de langue française : cas des apprenants du FLE de l’université de Calabar (Nigéria) par Eugenie Grace Essoh Ndobo et Veronica Ebica Odey |
(117 Ko) |
(106 Ko) |
Des variations orthographiques dans les dictées de CM1 par Jeanne Gonac'h |
(72 Ko) |
(60 Ko) |
La dictée de lettres : qu’en est-il au CM1 ? par Sophie Briquet-Duhazé |
(102 Ko) |
(88 Ko) |
La dictée dans les enquêtes sur la « littéracie » des adultes : pratiques, résultats, exemples d’analyses, perspectives par Jean-Pierre Jeantheau |
(385Ko) |
(334 Ko) |
La dictée dans l’enquête IVQ : variation et compétences d’écriture des scripteurs en difficulté avec l’écrit dans les régions Haute-Normandie et Rhône-Alpes par Carole Blondel et Jeanne Conseil |
(474 Ko) |
(431 Ko) |
La dictée dans un bilan orthophonique : analyse psycho-sociolinguistique des données de l’étalonnage du texte à trous d’Exalang 8-11 ans par Mickaël Lenfant |
(424 Ko) |
(395 Ko) |
Résumés
| La skrivadeg, une communion en paradoxes par Malo Morvan |
Cet article observe l'événement festif nommé "ar skrivadeg", dictée autour de la langue bretonne, apparue au début des années 2000 jusqu'à 2014. Les discours des promoteurs de l'événement nous montrent que ceux-ci défendent sa dimension fédératrice. Certes, cette dictée survient dans un contexte historique où les débats concernant les orthographes du breton se sont fortement apaisés. Néanmoins, il demeure des clivages entre différents profils de locuteurs, comme le montrent autant l'évolution des textes soumis à la dictée que les discours à son sujet dans le monde du militantisme breton. En ce sens, la rhétorique œcuméniste de ses promoteurs cache difficilement les désaccords qui subsistent encore quant à la définition même de ce que serait un "bon breton" susceptible d'être soumis à la dictée.
ajout d'un erratum (décembre 2017)
|
Télécharger cet article : |
format .pdf (207 Ko) | format
.zip (187 Ko) |
| Mise(s) en œuvre d’une activité orthographique : la dictée par Evelyne Delabarre et Marie-Laure Devillers |
Dans le lien étroit qui s’établit entre école et orthographe, cet article considère la place de la dictée dans les taches scolaires mises en place par les enseignants.
L’interrogation porte d’une part sur les formes de cette activité encore très ritualisée : différentes mises en œuvre, procédés discursifs, accompagnement à la transcription et d’autre part sur les conceptions des enseignants relatives à l’orthographe en particulier le statut de la dictée dans leurs pratiques de classe.
Mots clés : sociolinguistique, orthographe-dictée, pratiques enseignantes
| Télécharger cet article : | format .pdf (65 Ko) | format
.zip (55 Ko) |
| Pratiques de la dictée en classe de français dans l’enseignement secondaire au Cameroun. Analyse des approches et de la performance d’élèves dans un lycée à Ngaoundéré par Téguia Bogni et Mohamadou Ousmanou |
Au Cameroun, comme dans de nombreux pays francophones, la pratique de la dictée est une tradition. Activité emblématique, la dictée semble s’être pourtant figée en une activité monotone, avec des résultats de plus en plus déclinants. Même si cette activité garde son prestige et ses vertus, notamment pour ce qui est de l’apprentissage de certaines difficultés orthographiques, nous montrerons que, dans les pratiques, elle ne répond pas toujours au principe d’évaluation des enseignements effectivement dispensés. De même, les choix didactiques se trouvent quelquefois en contradiction avec la situation sociolinguistique, et débouchent sur des incongruités, comme celle qui consiste à opter pour une didactique du français langue première pour une population d’apprenants ayant déjà une langue première autre.
Mots clés : dictée, évaluation, didactique, français langue première, français langue seconde
| Télécharger cet article : | format .pdf (559 Ko) | format
.zip (547 Ko) |
| Quand la dictée devient un dispositif d’apprentissage par Danièle Cogis, Carole Fisher et Marie Nadeau |
Hors de la dictée, point de salut ! Voilà, en gros, le statut que cet exercice scolaire conserve depuis des décennies dans le domaine de l’enseignement du français. Après avoir examiné cet état de fait et rappelé que la dictée traditionnelle n’est ni un bon outil d’évaluation, ni un bon outil d’apprentissage, nous présentons dans cet article des formes de dictées qui, au contraire, permettent aux élèves d’apprendre par la réflexion et la résolution de problème. Nous précisons l’origine et les fondements de ces dispositifs innovants et en illustrons l’intérêt en présentant et discutant un exemple du déroulement de la phrase dictée du jour en contexte français. Suivent deux autres exemples (phrase dictée du jour et dictée 0 faute) provenant d’une recherche québécoise, laquelle a permis de démontrer l’effet très positif et statistiquement significatif de ces dictées métalinguistiques sur les compétences orthographiques des élèves. Certaines différences relevées dans la conduite de ces activités en contexte français et québécois nous amènent, en conclusion, à nous interroger sur leurs sources : s’agit-il de choix différents dans les démarches ou, encore, de différences culturelles plus profondes ?
| Télécharger cet article : | format .pdf (169 Ko) | format
.zip (150 Ko) |
| Une phrase dictée, trois enseignants, trois formes d’étayage par Catherine Combaz et Marie-Laure Elalouf |
Dans la lignée des travaux sur les conceptions orthographiques des élèves, nous avons observé la mise en œuvre d’une même dictée, comportant entre autres, des difficultés liées à l’orthographe du son [e] d’un verbe, dans trois classes de CM2, après avoir mené avec chaque enseignant un entretien semi-directif pour apprécier son rapport personnel et professionnel à l’orthographe. Ces observations ont permis de dégager des pratiques pédagogiques convergentes et divergentes quant à la façon même de dicter. Les interactions conduites pour lever les erreurs orthographiques des élèves font apparaitre différents types d’interventions des enseignants, plus ou moins en écho avec leurs représentations de l’enseignement/apprentissage de l’orthographe. Un regard orienté sur la variabilité de l’utilisation du langage et du métalangage dans ces situations de réflexion sur la langue permet de mettre au jour des « styles pédagogiques » qui portent trace de ce que sont ces enseignants dans leur « relation » à l’orthographe.
Mots clés : dictée, rapport à l’orthographe, pratiques enseignantes, interactions orales, manipulations linguistiques
| Télécharger cet article : | format .pdf (199 Ko) | format
.zip (183 Ko) |
| Conscience métalinguistique et norme orthographique : qu’apprend-on en corrigeant sa dictée ? par Véronique Miguel Addisu |
Le temps de correction d’une dictée participe de plein droit à l’apprentissage de l’orthographe. Si demander aux élèves de corriger leurs copies et les accompagner est une forme d’évaluation formative, toutes les manières de corriger une dictée ne se «valent » sans doute pas. On étudiera l’efficacité des corrections produites par des élèves de CM1 dans un corpus de copies recueillies lors d’observations ethnographiques dans 6 classes, représentatives de trois approches didactiques différentes (projet PEON). L’analyse montre que plus le maitre favorise un processus de validation de la norme orthographique, moins il y a d’erreurs, mais aussi moins de ressources pour les corrections. À l’inverse, plus le maitre favorise un processus d’apprentissage d’une posture métalinguistique, meilleure est la correction ; mais il y a aussi plus d’erreurs sous la dictée. Dans ces temps finalement assez peu formalisés, l’orthographe se construit en lien avec des apprentissages implicites d’un certain rapport aux normes, que l’on sait à la fois structurant pour la réussite à l’école et contribuant aux inégalités scolaires.
| Télécharger cet article : | format .pdf (212 Ko) | format
.zip (196 Ko) |
Le barème graduel : l’évaluation de la dictée au service des apprentissages par Sophie Anxionnaz |
Cet article est avant tout un compte rendu d’expérience : il s’agit de l’invention et de l’expérimentation d’un nouvel outil d’évaluation de la dictée, prenant appui sur les classes de troisième (série générale et 3ème prépa-pro) préparant au Diplôme National du Brevet. Après avoir été présenté à la Dgesco et testé au plan national pour sa maniabilité et ses effets docimologiques, le « barème graduel » est travaillé dans l’académie conceptrice en tant qu’évaluation positive qui doit permettre aux élèves de progresser. En effet, les performances des élèves au DNB en 2013 révèlent la diversité des compétences des élèves et la nécessité d’envisager la dictée dans une perspective d’évaluation formative. L’expérimentation, à la rentrée 2014, du barème graduel dans les classes ouvre alors des perspectives pédagogiques et didactiques propres à faire évoluer le regard et les pratiques sur un exercice emblématique de l’Ecole et sur l’apprentissage de l’orthographe en général.
Télécharger cet article : |
format .pdf (245 Ko) |
format
.zip (224 Ko) |
Difficultés et erreurs dans le passage de la phonie à la graphie en dictée de langue française : cas des apprenants du FLE de l’université de Calabar (Nigéria) par Eugenie Grace Essoh Ndobo et Veronica Ebica Odey |
La dictée est un exercice qui met à l’épreuve les aptitudes orales et écrites de l’apprenant. Elle implique inéluctablement le passage par l’apprenant, de la phonie (ce qu’il entend) à la graphie (ce qu’il écrit). Très souvent, ce passage est quelque peu perturbé ou affecté par des facteurs purement linguistiques (par exemple des incompétences en grammaire ou en orthographe) et sociolinguistiques/paralinguistiques (les interférences linguistiques) entre autres. Cet article qui se propose d’étudier le cas des apprenants nigérians du FLE montre la manière par laquelle les interférences des langues nigérianes (vernaculaires et véhiculaires) affectent ce passage de la phonie à la graphie en dictée. Les langues locales (interférentes) principalement considérées sont le Nigerian Pidgin (NP), le Yorouba, l‘Efik et l’Ibiobio. L’article s’appuie sur une analyse textuelle d’un corpus de 90 copies de dictée produites dans un contexte pédagogique par des apprenants de FLE de troisième et quatrième années ayant comme première langue les codes linguistiques susmentionnés.
Mots clés : Langues maternelles, Interférences Linguistiques, Phonie, Graphie, Dictée. FLE : Français comme Langue Etrangère
Télécharger cet article : |
format .pdf (117 Ko) |
format
.zip (106 Ko) |
Des variations orthographiques dans les dictées de CM1 par Jeanne Gonac'h |
Dans cet article, nous travaillons sur les variations orthographiques relevées dans les dictées d’élèves de CM1 scolarisés dans quatre écoles de la région rouennaise en Normandie. Les variations sont analysées dans une perspective qualitative à partir des travaux de Frei ([1929] 1971), et de Millet et Lucci (1994). Les types de variation révèlent d’abord une conscience élevée de l’irrégularité du français car les élèves n’utilisent jamais de façon mécanique les règles d’orthographe du français. Ils montrent également que la majorité des élèves répondent au besoin de sécurité dans le cadre très contraint de la dictée.
Télécharger cet article : |
format .pdf (72 Ko) |
format
.zip (60 Ko) |
La dictée de lettres : qu’en est-il au CM1 ? par Sophie Briquet-Duhazé |
Si la dictée demeure un exercice de l’enseignement/apprentissage de l’orthographe à l’école élémentaire, elle suppose une compétence de base : la connaissance des lettres. Cette connaissance des lettres en isolé se décline en trois valeurs : la connaissance du nom, du son et de la graphie. Notre recherche longitudinale porte sur le niveau de conscience phonologique et la connaissance des lettres chez des élèves âgés de 8 à 11 ans. Nous présentons ici la dictée de lettres au cycle 3 après avoir précisé les résultats concernant le nom des lettres. L’objectif est de montrer que des élèves de cycle 3 peuvent ne pas maitriser la dictée de lettres de l’alphabet, non pas uniquement à cause d’une difficulté du geste graphique mais surtout parce que ces élèves ne connaissent pas le nom des 26 lettres de l’alphabet.
Télécharger cet article : |
format .pdf (102 Ko) |
format
.zip (88 Ko) |
La dictée dans les enquêtes sur la « littéracie » des adultes : pratiques, résultats, exemples d’analyses, perspectives par Jean-Pierre Jeantheau |
L’enquête Information et Vie Quotidienne (IVQ), conduite par l’INSEE en partenariat avec de nombreuses organisations et équipes universitaires vise à évaluer les compétences des adultes face à l’écrit et à repérer ceux qui peuvent être considérés comme ayant des difficultés lorsqu’ils sont confrontés à des tâches de leur vie de tous les jours impliquant l’écrit. Il n’est donc pas surprenant, a priori, que figure dans cette enquête une épreuve intitulée Production d’Ecrit (PE), qui est en fait une dictée de mots, une production écrite sous contrainte phonologique, d’autant que l’orthographe tient une place toute particulière en France dans le débat autour de la maitrise de la langue française écrite.
Pourtant la présence de cette dictée n’est pas due à la volonté de tester l’orthographe des personnes que l’on soupçonne d’avoir des difficultés avec l’écrit (lecture et compréhension), mais à un ensemble de contraintes techniques. Ce sont certainement les mêmes qui sont à l’origine de l’absence de ce genre d’épreuve dans les enquêtes nationales ou internationales sur la « littéracie », réduisant le champ de ces enquêtes à la compréhension de l’écrit et faisant de l’enquête IVQ une originalité dans le monde des enquêtes sur grand échantillon.
Dans le cadre de l’enquête IVQ, il est impossible de déterminer, de façon directe, si la dictée est un bon estimateur de la capacité des individus testés à produire du sens à l’écrit. Néanmoins nous nous nous interrogerons sur les liens entre les performances au Module PE et les performances enregistrées dans les autres modules : lecture, compréhension écrite, compréhension orale du français standard et également le module « Numeracie » (calcul de la vie de tous les jours) à travers les résultats de l’enquête IVQ 2011 en Métropole.
Enfin, si la dictée est un exercice courant dans la plupart des systèmes scolaires, avec une prédominance dans les années de formation primaire, les corpus de dictées d’adultes sont extrêmement rares. Nous essaierons de montrer, sans vraiment approfondir les analyses, ce que peut offrir ce type d’enquête comme opportunités de recherche, et ce que la recherche peut apporter à la conception de ce genre d’enquête.
Télécharger cet article : |
format .pdf (385 Ko) |
format
.zip (334 Ko) |
La dictée dans l’enquête IVQ : variation et compétences d’écriture des scripteurs en difficulté avec l’écrit dans les régions Haute-Normandie et Rhône-Alpes par Carole Blondel et Jeanne Conseil |
Cet article présente une étude exploratoire des 368 dictées produites par les scripteurs haut-normands et rhônalpins repérés en difficulté avec l’écrit dans l’enquête IVQ 2011.
Nous proposons une analyse descriptive et comparative de la variété des compétences orthographique et phonographique en production écrite sur 16 mots de la dictée. L’étude quantitative du taux de variation entre les deux régions, a tout d’abord permis de mettre en évidence la variété des compétences orthographiques des scripteurs en difficulté. Le calcul des scores de réussite a ensuite permis d’établir des profils de scripteurs selon deux critères : le critère orthographique, axé sur les compétences lexicales et, le critère phonographique fondé sur la conformité phonographique de la forme produite, avec pour objectif de déterminer le niveau de conscience phonémique des enquêtés. Nous montrons ainsi qu’une analyse particulière est nécessaire pour évaluer les compétences en production de mots écrits d’un public en difficulté, à partir d’une épreuve de dictée. La prise en compte du critère phonographique dans la réussite des productions en plus du critère orthographique nous semble en effet indispensable pour différencier les capacités d’écriture et pour distinguer les scripteurs qui, malgré un rapport difficile à la norme, possèdent de réelles compétences à l’écrit, de ceux qui sont en grande difficulté avec la langue écrite, tant sur le plan orthographique que sur le plan phonographique.
Mots clés : Variation orthographique, Capacité d’écriture, Compétences orthographiques, Compétences phonographiques, Public en difficulté
Télécharger cet article : |
format .pdf (474 Ko) |
format
.zip (431 Ko) |
La dictée dans un bilan orthophonique : analyse psycho-sociolinguistique des données de l’étalonnage du texte à trous d’Exalang 8-11 ans par Mickaël Lenfant |
Dans cet article, nous analysons d’un point de vue psycholinguistique et sociolinguistique les résultats et le corpus issus du testing d’une dictée à trous extraite d’un bilan orthophonique informatisé. A la différence de l’école, où les résultats de l’élève sont comparés par rapport à une note maximale et à la moyenne de sa classe ; en orthophonie, les résultats d’un patient sont comparés par rapport à la moyenne des enfants de son âge ou de son niveau scolaire. C’est à la manière dont cette moyenne se construit que nous nous intéressons. À travers deux approches croisées, à la fois quantitative et qualitative, les objectifs sont de souligner l’intérêt de construire des normes « écologiques », qui intègrent la variation orthographique, et de déterminer l’importance de variables sociologiques (sexe, milieu scolaire, milieu socioprofessionnel). Nous précisons également la notion de seuil de pathologie et mettons en avant l’importance d’une analyse fine des erreurs, notamment pour diagnostiquer une dysorthographie.
Télécharger cet article : |
format .pdf (424 Ko) |
format
.zip (395 Ko) |
Dernière
mise à jour :
15 juillet 2015
GLOTTOPOL
GLOTTOPOL
GLOTTOPOL